Parcoursup : mode de fonctionnement
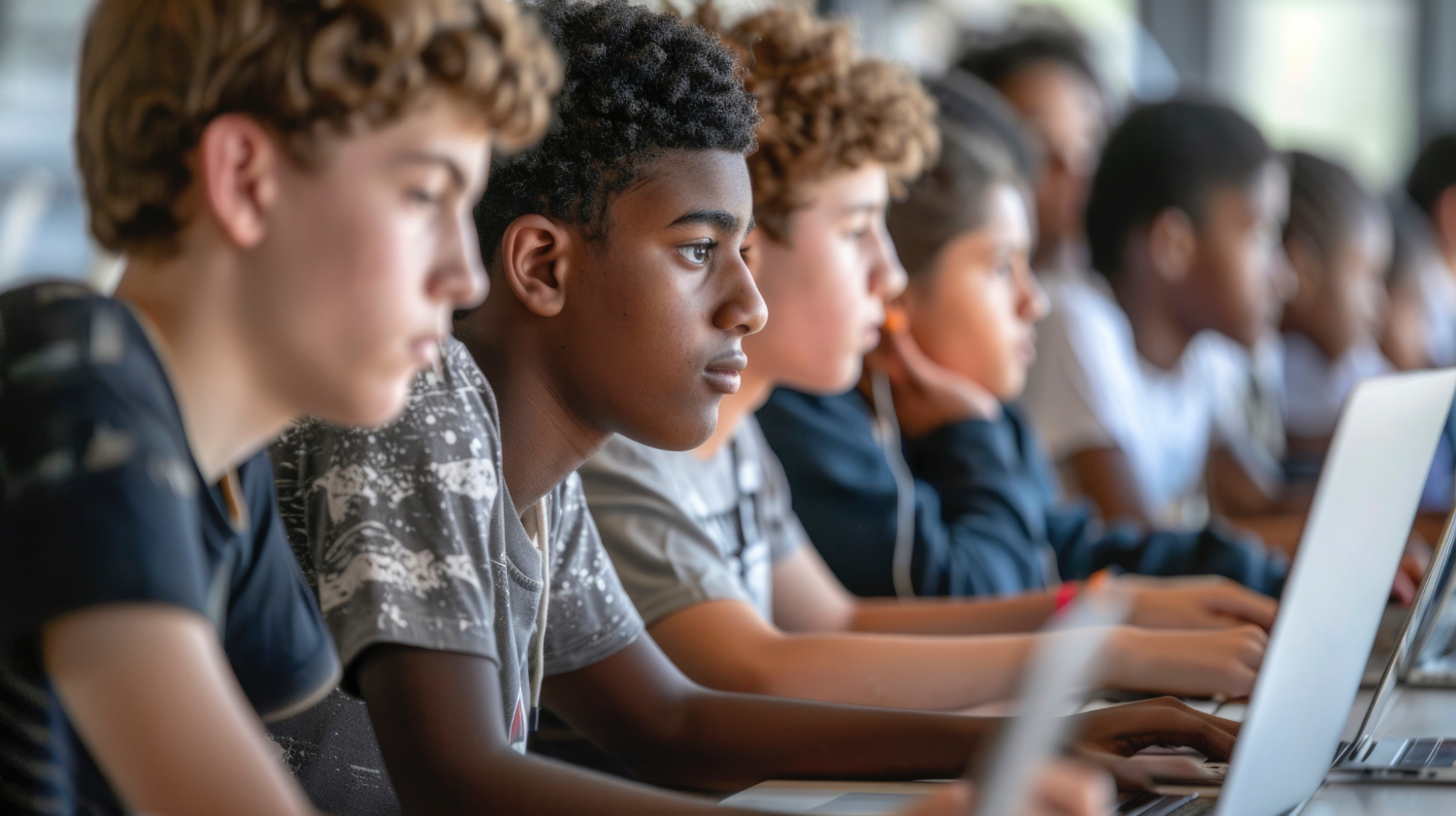
En 2024, on compte 916 000 demandeurs d'admission en première année d’un premier cycle de l'enseignement supérieur français. Parmi eux, 645 000 sont des élèves en classe terminale dans des lycées français (y compris ceux des lycées français à l’étranger), 170 000 sont des étudiants redoublant leur première année d’études supérieures et souhaitant une réorientation (ceux qui redoublent dans la même filière n’utilisent pas le portail Parcoursup), 66 000 sont des personnes voulant reprendre leurs études après une période de vie active, et 35 000 sont des candidats en classe terminale dans l’enseignement secondaire à l’étranger, souhaitant étudier en France.
En face de ces candidats, un peu plus de 23 000 formations supérieures de niveau premier cycle exigent que les postulants expriment leurs candidatures via le portail Parcoursup. À cela s’ajoutent plusieurs milliers de formations proposées par des établissements privés recrutant « hors Parcoursup », en France ou à l’étranger.
Parmi ces formations, on distingue les formations sélectives (sections de techniciens supérieurs, instituts universitaires de technologie, grandes écoles, classes préparatoires, etc.) et les formations non sélectives, accessibles à tout bachelier ou titulaire d’un diplôme équivalent (principalement des licences universitaires).
Une autre distinction concerne la durée des études : certaines formations sont dites « courtes » (2 à 3 ans), car elles préparent les étudiants à entrer rapidement sur le marché de l’emploi, tandis que d’autres sont qualifiées de « longues » (5 ans ou plus). De plus, certaines formations sont immédiatement professionnelles, tandis que d’autres débutent par un cycle général avant de se spécialiser.
De l’expression des candidatures directes aux procédures télématiques
Jusqu’aux années 1980, les candidatures aux établissements d’enseignement supérieur étaient gérées localement. Cependant, avec l’augmentation du nombre de bacheliers (de 40 000 en 1950 à 645 000 en 2024), cette méthode est devenue inadaptée.
Les avancées en informatique ont permis de créer des outils de gestion des candidatures. Le premier système de ce type, RAVEL, a été mis en place dans les académies d’Ile-de-France à la fin des années 1980. Par la suite, d’autres plateformes comme Bretasup (Rennes) ou Racine (Toulouse) ont vu le jour. Cependant, ces systèmes étaient limités aux académies locales, alors que de plus en plus de bacheliers souhaitaient étudier en dehors de leur région.
Face à cette situation, un « guichet national unique » est devenu nécessaire. C’est ainsi qu’est né APB (admission post bac) au début des années 2000, remplacé en 2018 par Parcoursup, toujours en usage aujourd'hui.
Qu’est-ce que Parcoursup ?
Parcoursup est un algorithme conçu pour affecter chaque année près d’un million de candidats à l’une des 23 000 formations disponibles sur le portail. Il s’inspire de l'algorithme des « mariages stables » de Gale et Shapley, qui vise à maximiser les chances de réussite des associations entre candidats et formations.
Officiellement, Parcoursup est régi par la loi ORE (loi « orientation et réussite des étudiants », N°2018-166 du 8 mars 2018) et par un arrêté du 19 juin 2018. Ses fonctions incluent une phase d’information, la collecte des vœux des candidats, et la constitution de dossiers contenant les résultats scolaires, les appréciations des enseignants, ainsi qu'une lettre de motivation.
Les dossiers sont ensuite examinés et classés par les établissements, même pour les formations non sélectives. Les candidats reçoivent ensuite les propositions d’admission via Parcoursup et doivent valider l’une d’elles dans un délai imparti sous peine de la perdre.
Pour ceux qui n’obtiennent aucune proposition, Parcoursup les accompagne vers une solution. Une fois une proposition acceptée, les inscriptions administratives et pédagogiques se déroulent directement avec l’établissement concerné.
Le calendrier annuel de Parcoursup
Parcoursup fonctionne chaque année de début novembre à la mi-septembre, avec une succession d'étapes appelées "phases". Ces phases restent les mêmes d'une année sur l'autre, à quelques jours près.
La première phase, dite d'information, commence début novembre et se poursuit jusqu'au 17 janvier 2025. Durant cette période, il n’est pas encore possible de formuler des vœux. Les inscriptions, en revanche, débutent le 17 janvier 2025. Cette phase est cruciale pour obtenir des informations actualisées sur le fonctionnement de Parcoursup et sur les plus de 23 000 formations disponibles. Chaque formation présente ses "attendus", c'est-à-dire les compétences et connaissances requises, ainsi que les détails des éventuelles épreuves de sélection.
Il est conseillé de commencer à s'informer et à réfléchir aux orientations possibles avant l'ouverture de cette phase, notamment en profitant des journées portes ouvertes, salons d'orientation et autres événements informatifs.
À partir du 17 janvier 2025, la phase d'inscription débute et se prolonge jusqu'au 14 mars 2025. Les candidats doivent créer leur dossier, s'assurer de son exactitude et formuler leurs vœux ainsi que leurs sous-vœux. Passée cette date, il ne sera plus possible d'ajouter de nouvelles candidatures.
La phase de validation du dossier se déroule du 15 mars au 3 avril 2025. Pendant cette période, les candidats peaufinent leur "projet motivé" (équivalent d'une lettre de motivation) pour chaque vœu. Ils peuvent aussi ajouter des informations sur leurs activités et centres d'intérêt, et exprimer leur préférence parmi leurs vœux. À la fin de cette phase, tous les dossiers sont envoyés à Parcoursup, qui les transmet aux établissements d'enseignement supérieur concernés.
Du 4 avril au 30 mai 2025, les dossiers sont examinés par les commissions d’examen des vœux des établissements supérieurs, qui classent les candidats et leur envoient les réponses.
La phase de réponse aux candidatures commence le 30 mai et se termine le 12 juillet 2025. Si la plupart des réponses sont communiquées dans la première semaine, certains candidats devront peut-être attendre plus longtemps. En 2024, 85 % des candidats avaient reçu une réponse au 15 juin. Les candidats doivent répondre rapidement aux propositions d'admission sous peine de les perdre.
Une phase d’admission complémentaire, qui se déroulera du 11 juin au 12 septembre 2025, est destinée aux candidats n'ayant reçu aucune proposition ou ayant refusé celles obtenues. Environ 85 000 candidats se trouvaient dans cette situation en 2024, mais seule la moitié d'entre eux a utilisé cette opportunité pour obtenir une place.
Combien de vœux est-il possible d’exprimer ?
Sur Parcoursup, un vœu correspond à une candidature pour une formation précise. Chaque candidat peut exprimer jusqu'à dix vœux et dix sous-vœux, soit un total maximum de vingt candidatures. Il est possible d'ajouter des vœux pour des formations en apprentissage, avec les mêmes limites.
L'ancienne plateforme APB obligeait les candidats à hiérarchiser leurs vœux, mais ce n'est plus le cas avec Parcoursup depuis 2018. Cependant, il est recommandé de hiérarchiser ses vœux à un stade ultérieur afin de réduire les délais d’attente et de faciliter le choix en cas de multiples propositions.
Depuis 2022, les candidats peuvent indiquer leur préférence quelques semaines après la phase de réponse des établissements, ce qui a permis de raccourcir les délais d'attente. La date pour 2025 sera probablement fixée autour de la première quinzaine de juin.
Les réponses que les candidat(e)s peuvent recevoir
Chaque vœu fait l'objet d'une réponse par la commission d'examen des vœux (CEV) des formations demandées. Voici les quatre réponses possibles sur Parcoursup :
- « Oui » : C’est une proposition d’admission.
- « Oui si » : Réservée aux formations non sélectives, cette réponse implique que l'étudiant doit suivre un parcours d'accompagnement pour réussir. Elle vise à alerter le candidat sur un risque d'échec en raison de son profil inadapté. Les dispositifs de soutien sont variés (modules de soutien, tutorat, étalement de la première année, etc.), mais souvent insuffisants. En 2023/2024, seuls 13% des étudiants ayant reçu un « oui si » ont réussi à passer en deuxième année.
- « En attente » : Le candidat n'est pas encore admis, mais pourrait l'être si des places se libèrent. La gestion des listes d'attente est souvent complexe et stressante pour les candidats.
- « Non » : Réponse définitive des formations sélectives, elle met fin à la possibilité d'admission dans cette formation.
Les candidats peuvent recevoir plusieurs réponses « oui » et/ou « en attente » pour différents vœux. Il leur appartient alors de choisir la formation la plus attrayante pour eux et d'éventuellement patienter pour une meilleure opportunité en liste d’attente. Un exemple réel montre comment un élève a patienté deux semaines pour finalement recevoir un « oui » pour la formation la plus souhaitée.
Parcoursup amplifie-t-il la sélection ?
On accuse souvent Parcoursup d’accentuer la sélection à l'entrée dans l'enseignement supérieur, mettant en péril le droit pour tout bachelier d'accéder à une place. La sélection n’est pas nouvelle, mais Parcoursup oblige même les formations non sélectives à classer les candidats, réduisant ainsi le libre accès. Cependant, cela ne concerne que 15% des places sur Parcoursup, principalement dans les filières à capacités d'accueil limitées comme le droit, STAPS, et psychologie.
Les dossiers de candidatures ne sont pas uniquement classés par une machine
Contrairement à une idée reçue, les dossiers ne sont pas entièrement gérés par un algorithme. Parcoursup est un « outil d’aide à la décision » qui soutient les commissions d’examen des vœux (CEV). L'importance de cet outil varie selon le nombre de candidatures reçues par chaque formation. Dans les grandes filières avec beaucoup de candidats, comme le droit, l'outil est plus largement utilisé, mais l’analyse humaine reste importante, notamment avec l’intégration de critères locaux.
Cependant, l'algorithme national ne prend pas en compte l’« effet établissement », c’est-à-dire les différences de notation entre établissements. Cela amène certaines formations à ajouter des paramètres locaux pour affiner leur classement, et certaines familles à adapter leurs stratégies en fonction des établissements perçus comme trop sélectifs ou trop exigeants.
Les quotas de places réservées (candidats boursiers, bacheliers technologiques, etc.) sont également appliqués par l'algorithme, qui ajuste les classements en fonction de ces quotas avant l'envoi des réponses finales.
Conclusion
L’inégalité algorithmique dans les dossiers Parcoursup pousse certaines familles à éviter les établissements trop sélectifs, ce qui affecte la manière dont les établissements scolaires évaluent leurs élèves.
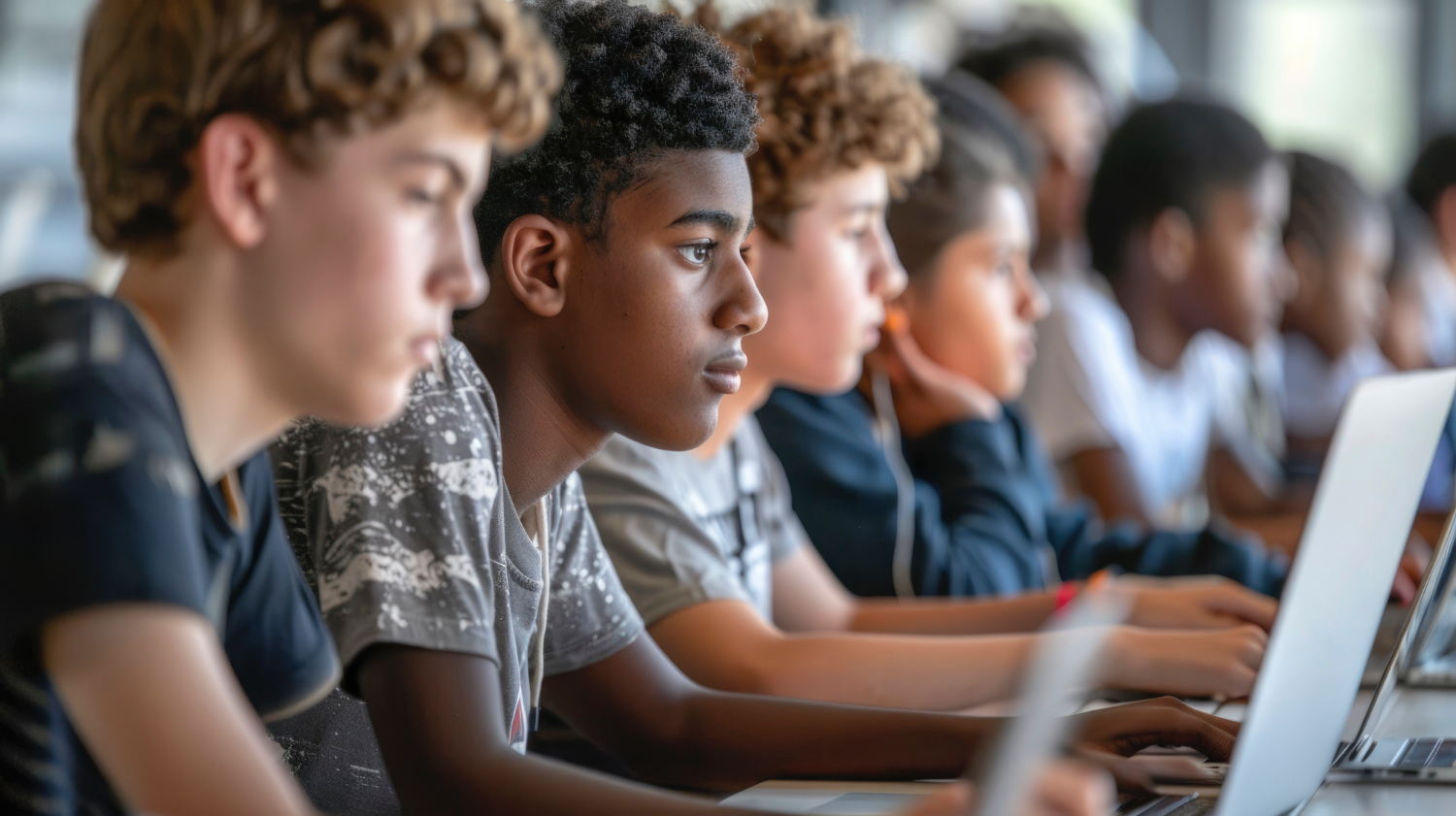
SOURCE : EDUCAVOX

Nos réalisations
Découvrez nos références, nos réalisations et nos travaux pour des établissements.
C'est tout frais de nos experts

Optimiser la communication au sein des établissements scolaires

Conjuguer les intelligences en communication éducative : pourquoi votre campagne doit croiser plusieurs cibles


