Intelligence artificielle : quelles projections pour l’enseignement supérieur en 2035 ?
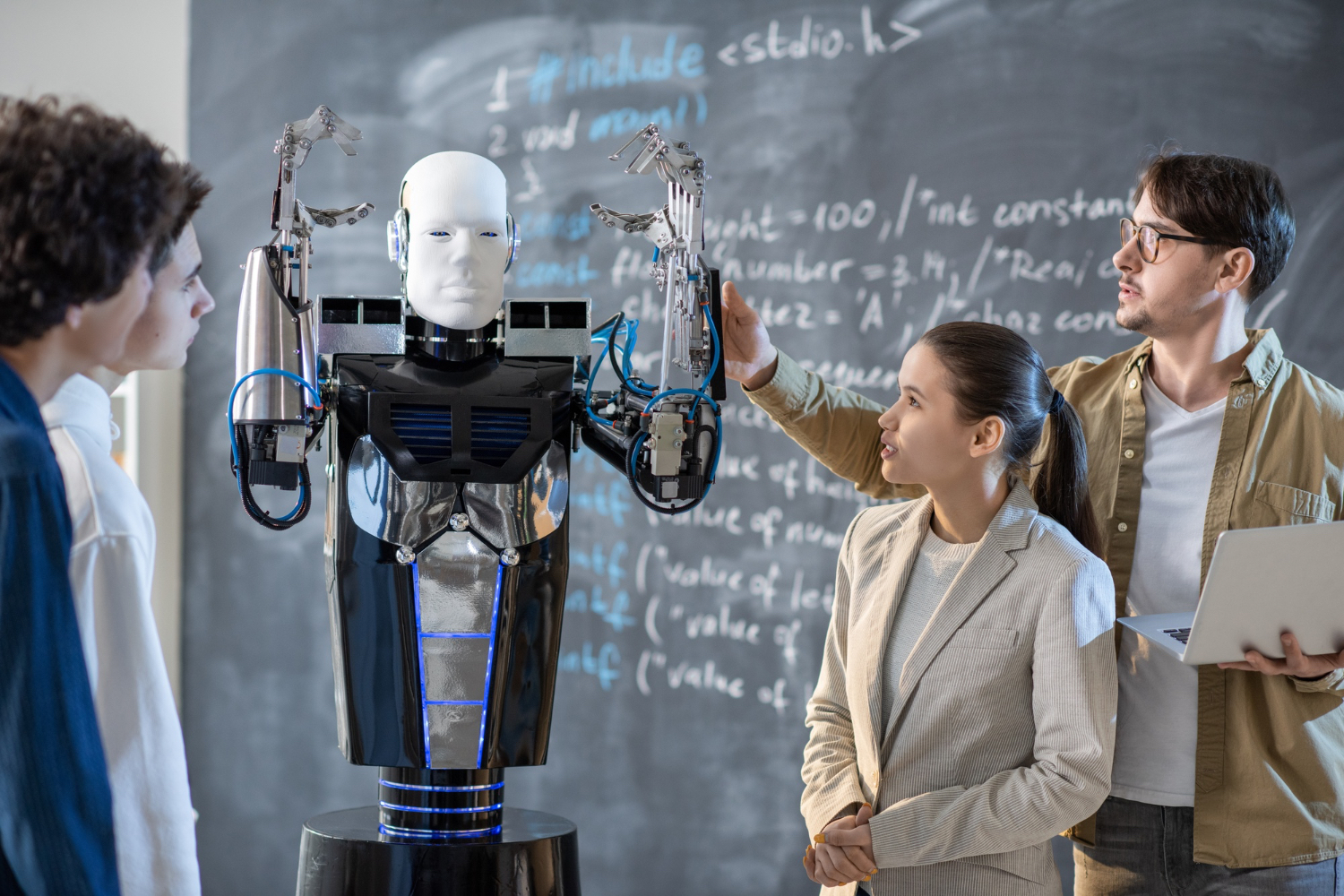
L’association américaine Educause donne à voir une projection sur ce que l’enseignement supérieur pourrait devenir à l’horizon 2035 sous l’impulsion de l’adoption des IA génératives, dans un rapport publié le 29 septembre 2025. Plusieurs recommandations sont formulées, comme gagner en souplesse et considérer les IA génératives comme des outils créatifs, et non pas comme un moyen de remplacer les enseignants. La création de nouveaux outils d’IA est aussi mise en avant, à la fois pour faciliter le parcours étudiant, mais aussi pour répondre à des besoins propres à chaque discipline.
Une projection ambitieuse pour l’enseignement supérieur
L’association Educause publie une projection de l’usage de l’IA générative dans l’enseignement supérieur à l’horizon 2035, dans un rapport publié le 29 septembre 2025.
Educause publie, le 29 septembre 2025, un nouveau rapport nommé “2025 Horizon Action Plan : Building skills and literacy for teaching with GenAI”. L’objectif de cette association américaine est de proposer une projection à dix ans de la manière dont l’IA générative aura bouleversé l’enseignement.
Six domaines clés sont particulièrement identifiés :
- Outils d’IA pour l’enseignement et l’apprentissage
- Développement du corps professoral pour l’IA générative
- Gouvernance de l’IA
- Renforcement de la cybersécurité
- Évolution des pratiques pédagogiques
- Littératie numérique critique
Un futur où l’IA est pleinement intégrée dans les pratiques
Le rapport rend compte de la vision “préférée” — et plutôt positive — de ses contributeurs pour cette projection à 2035. Ainsi, il est anticipé que le grand public accorde une confiance “renouvelée” dans l’enseignement supérieur, mais aussi que des réponses aient été apportées aux problématiques budgétaires et que les “divisions politiques” aient été dépassées. “Grâce à la formation technique et aux partenariats avec l’industrie, les étudiants acquièrent une expérience pratique des outils dont ils ont besoin pour être compétitifs sur le marché du travail”, assure Educause.
La projection émet aussi l’hypothèse d’un usage éthique de l’IA, avec des cadres construits de manière collaborative et une transformation numérique pleinement embrassée par les personnels de l’enseignement supérieur. “Les enseignants et le personnel considèrent les technologies émergentes, telles que l’IA générative, comme des catalyseurs et non des substituts.”
Enfin, les outils d’IA génératives ont été pleinement intégrés dans l’expérience d’apprentissage, notamment pour améliorer les supports de cours et l’acte d’évaluation. “Les étudiants ont désormais accès à des évaluations immédiates, à des technologies d’apprentissage immersives et à des outils réduisant la charge cognitive. Les étudiants, les enseignants et le personnel évaluent les outils d’IA générative de manière critique”, est-il écrit.
Incorporer l’IA dans la classe et en dehors
Pour parvenir à ce futur, plusieurs actions sont recommandées dans le rapport, aussi bien au niveau individuel qu’à l’échelle de départements ou de collaborations entre institutions et établissements.
Par exemple, il est conseillé de gagner en “souplesse” et de considérer les IA génératives comme des “outils créatifs” et non pas un moyen de remplacer l’enseignant, tout en demeurant attentif aux implications éthiques et sociales de cette technologie. Il faut aussi “réinventer comment accompagner les étudiants à l’ère de l’IA, en renforçant la confiance et les liens entre étudiants, enseignants et personnels”, et “favoriser le sentiment d’appartenance des étudiants pour améliorer leurs expériences d’apprentissage, réduire les écarts de réussite et favoriser la rétention”.
Inclure l’IA dans les cours, mais aussi en dehors des classes, est recommandé : “cela permettra de soutenir les étudiants en tant que citoyens d’une société numérique et de leur donner une base plus solide pour le développement de leurs compétences professionnelles.” Cependant, cette mise en œuvre à grande échelle “nécessitera du temps et un budget important, notamment pour la formation des enseignants et du personnel”, ce qui renvoie à la formation continue. Plus généralement, il est recommandé de revoir les programmes de formation à l’aune de la montée en puissance de l’IA.
Créer des outils et répondre aux besoins propres à chaque discipline
Sur l’échelle des départements et facultés, il est conseillé de mettre en œuvre des politiques claires et flexibles sur l’IA, adaptées aux enjeux et besoins de chaque discipline. Créer de nouveaux outils d’IA génératives est recommandé, par exemple pour faciliter la vie étudiante (planification des cours, soutien pour accéder aux aides financières, etc.), mais aussi pour répondre à des besoins propres aux différentes disciplines. Le tout, en adoptant une démarche d’évaluation sur le “retour sur investissement” des différents outils.
Des collaborations sont encouragées entre facultés, par exemple pour créer des communautés de pratiques, repenser l’évaluation et diversifier les approches pédagogiques : “Tout comme les outils d’IA générative incitent les enseignants à réinventer les évaluations, ils bouleversent notre façon de concevoir l’apprentissage lui-même. Comment les processus d’apprentissage des étudiants évoluent-ils à l’ère du numérique ? Quelles nouvelles approches peuvent soutenir la motivation et l’engagement des étudiants ?”
Collaborer entre établissements
Le rapport prône aussi le développement de collaborations entre les établissements et d’autres organismes liés à l’enseignement supérieur, afin de mieux répondre à des enjeux partagés. Ainsi, “créer une compréhension commune de la réussite des étudiants et améliorer l’harmonisation des programmes entre les établissements” permettrait de tendre vers plus d’égalité et de partage des ressources. Mais il faut veiller à ne pas pousser le curseur trop loin afin de préserver la diversité et respecter “l’identité” de chacun.
Le rapport insiste également sur le besoin de renforcer les synergies avec le monde du travail, sur plusieurs domaines. D’une part, afin d’améliorer “l’employabilité des étudiants” et favoriser la formation continue ; et d’autre part, pour “améliorer l’alignement des décisions d’achat sur les objectifs et missions d’établissement, réduire les coûts technologiques, optimiser l’expérience des étudiants et des enseignants”, ou encore “promouvoir la recherche et le développement en technologies éducatives”.
Planifier une feuille de route
Le rapport identifie deux axes de méthode de travail pour “relever ces défis” :
- Comprendre les besoins de l’institution, notamment en cartographiant les différentes parties prenantes et en documentant l’état des lieux de départ, les enjeux, mais aussi en identifiant les “alliés” qui souhaitent agir sur le sujet de l’IA, tout en veillant à être en phase avec les valeurs de l’institution.
- Élaborer une feuille de route, en planifiant des actions à la fois de court, moyen et long termes, mais aussi en distinguant les activités “faciles” à porter et les plus complexes, tout en gardant en tête le futur “préféré” qui est visé.
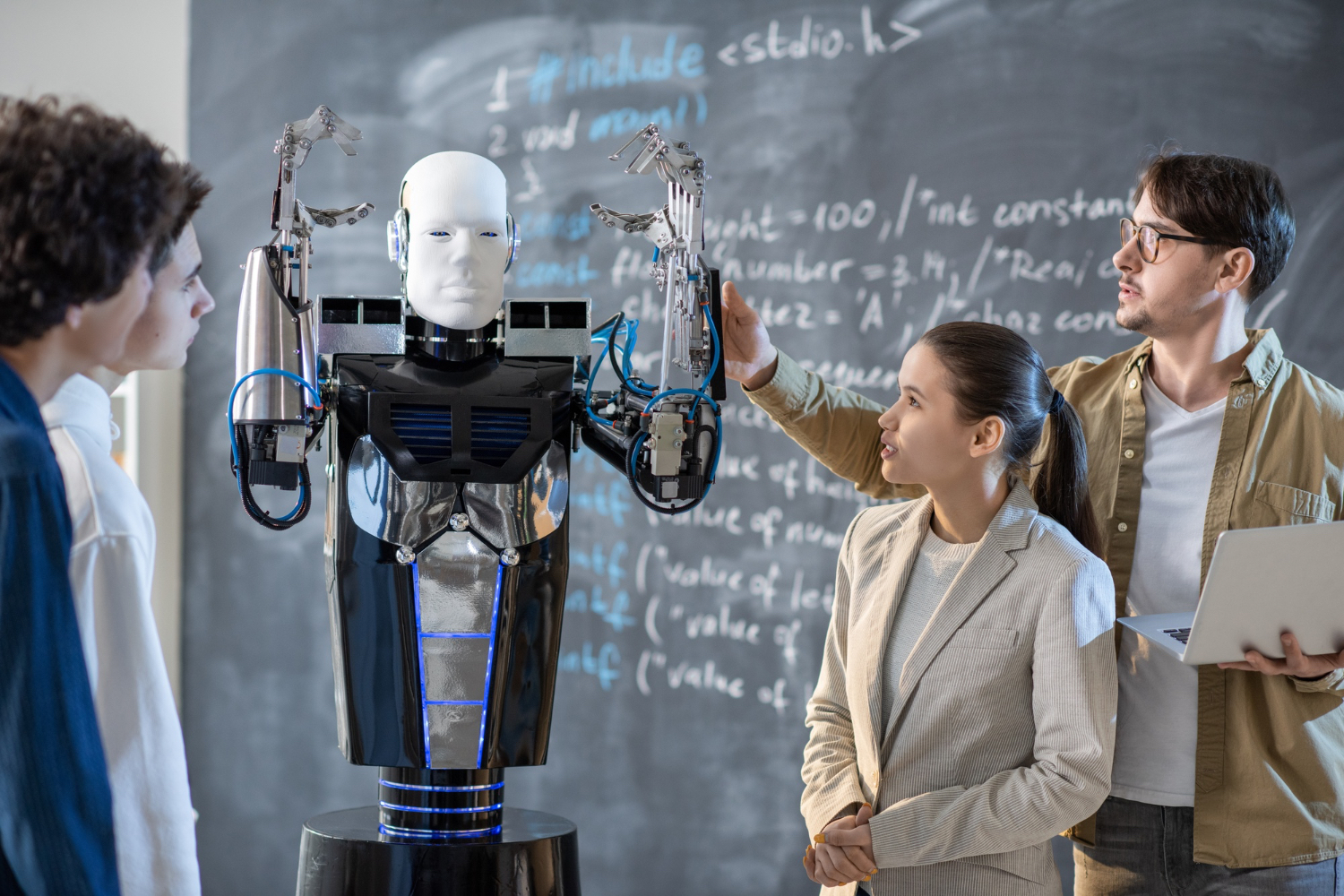
SOURCE : AEF INFO

Nos réalisations
Découvrez nos références, nos réalisations et nos travaux pour des établissements.
C'est tout frais de nos experts

Optimiser la communication au sein des établissements scolaires

Conjuguer les intelligences en communication éducative : pourquoi votre campagne doit croiser plusieurs cibles


