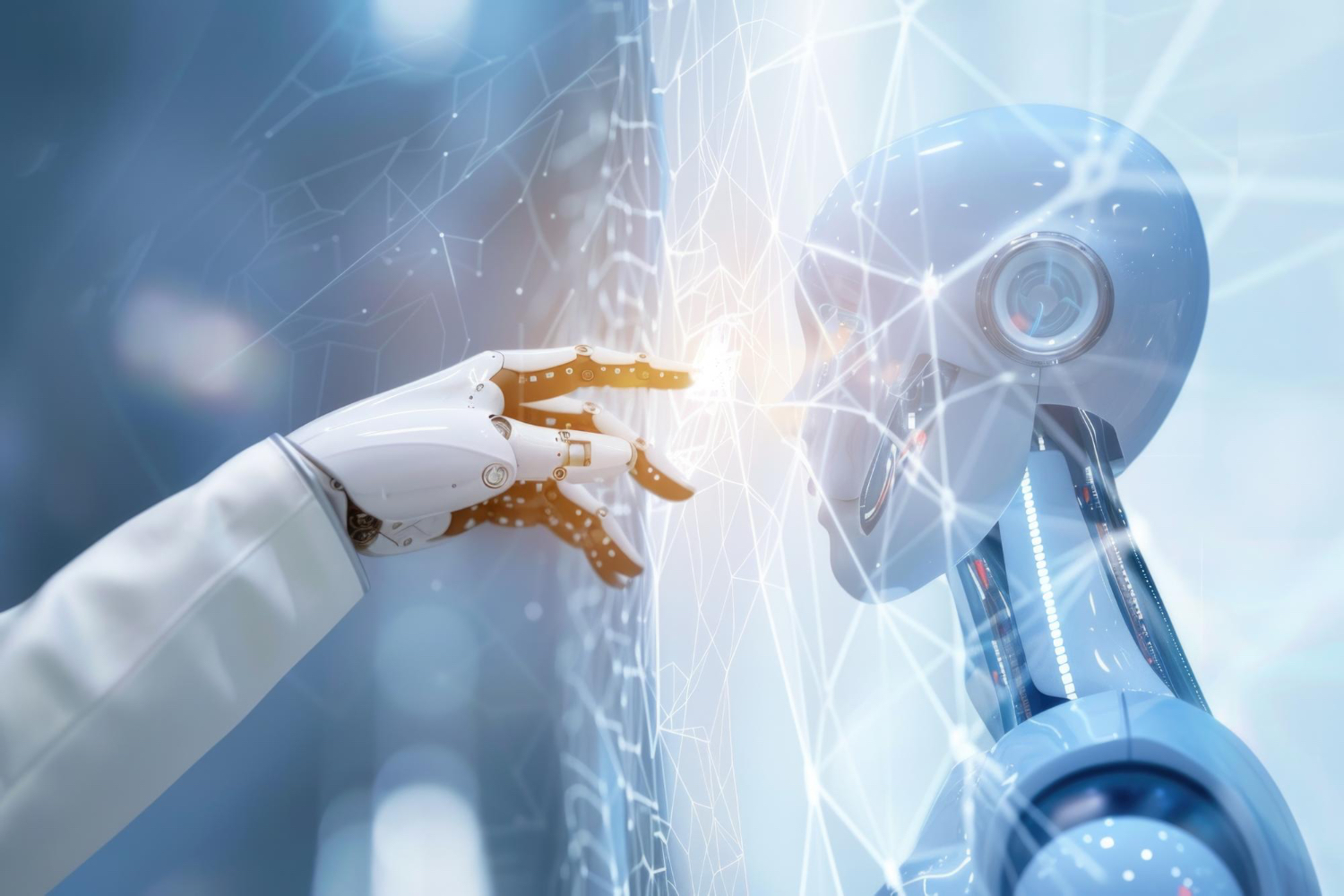Aider les étudiants à trouver leur voie et les diplômés en recherche d’emploi

Depuis quelques années, de plus en plus d’universités s'engagent dans le développement et la structuration de leurs réseaux d'anciens, à l'image des pratiques déjà établies dans les écoles privées, mais sans les moyens financiers équivalents. En février 2023, l’université de Franche-Comté a lancé son réseau d’alumni, 600 ans après sa fondation à Dole par Philippe Le Bon. En avril 2024, l’université de Caen, tout aussi ancienne que celle de Franche-Comté, a annoncé le lancement de son propre réseau d'anciens. Bien que de plus en plus d'universités prennent conscience de l'importance de développer ces réseaux, elles accusent encore un retard considérable par rapport aux établissements privés, qui forment pourtant moins d'étudiants.
« C’est vrai, le sujet a longtemps été laissé de côté dans les universités », reconnaît Anne Monneret, responsable du réseau des alumni de l’université franc-comtoise. « Mais les choses ont évolué depuis la crise du Covid. De nouvelles pratiques se sont mises en place, notamment grâce aux réseaux sociaux qui facilitent les mises en relation. Aujourd'hui, il est essentiel de mobiliser nos diplômés. » Pour mettre en place son réseau d’alumni il y a 18 mois, l’université de Franche-Comté a investi des moyens ambitieux, incluant un budget dédié et un prestataire spécialisé. Sa plateforme numérique en ligne offre l'accès à un annuaire de 16 000 membres (étudiants, diplômés, personnels, partenaires, recruteurs), ainsi qu'un « career center » proposant des annonces de recrutement, de stages ou d'alternance, et une liste des groupes ou communautés déjà existants au sein de l'université, souvent créés par des enseignants-chercheurs ou étudiants.
Ainsi, à l’IUT de Franche-Comté, chaque département a un groupe sur LinkedIn depuis 2018, offrant un espace dédié aux étudiants et diplômés. Christelle Rossé Bloch, enseignante-chercheuse à l’IUT, a pris l'initiative de créer le groupe du BUT Métiers du multimédia et de l’internet. « Nous gérons le groupe comme nous pouvons, plaisante-t-elle. Nous ne sommes pas des spécialistes, mais j'ai tout de même réussi à y rassembler 635 personnes sur 1500 diplômés depuis la création de notre diplôme. C'est pas mal ! J’y partage chaque semaine des nouvelles de nos anciens, des offres d’emploi, de stages, et je relaie des candidatures. »
Ce n’est pas qu’un annuaire et des goodies
Parmi les universités qui se distinguent dans le développement de leurs réseaux d’alumni, celle de Strasbourg est un bon exemple. Son réseau, lancé en 2012, est soutenu par un service dédié, intégré à l’université et dirigé par Agnès Villanueva, directrice du service relations alumni. « Aujourd'hui, notre réseau compte 56 000 membres. Mais un réseau d’alumni tel que nous le concevons ne se limite pas à un annuaire et des goodies ! L’entraide professionnelle est au cœur de notre démarche. Ce réseau est là pour aider nos étudiants à trouver leur voie, mais aussi nos diplômés en recherche d’emploi. »
Pour les années à venir, l’université alsacienne souhaite également mieux valoriser sa recherche et ses chercheurs. « Notre projet est de permettre à tous—étudiants, diplômés, personnels, recruteurs—de se connecter à ce qui se passe dans nos laboratoires de recherche, afin de se tenir informés des évolutions dans leur domaine, dans une logique de formation continue. Nous avons donc lancé des podcasts sur la science avec nos chercheurs, ainsi que des visites de laboratoires, ouvertes à nos diplômés et aux entreprises. »
Développer un véritable réseau d’alumni au service des étudiants et des diplômés est donc possible, même pour les universités. Cependant, cela nécessite un personnel dédié (six personnes y travaillent à temps plein à l’université de Strasbourg) et un budget, souvent difficile à obtenir dans des établissements systématiquement sous-dotés par les gouvernements successifs. Agnès Villanueva souligne aussi que mobiliser les anciens de l’université n’est pas toujours aisé, car le réflexe « alumni » n’est pas encore très répandu chez les diplômés des universités françaises, souvent par méconnaissance d’un tel service durant leurs études. « Ce réseau mérite d’être davantage exploité par les personnels de l’université et les étudiants, car il constitue un trésor humain qui grandit chaque année. »
Il existe une vraie différence avec les étudiants des écoles de commerce, qui savent qu’en payant leurs frais de scolarité, ils accèdent également à un réseau d’alumni bien établi, intégré au « package » global, aux côtés du BDE et des activités associatives.
N’importe quel étudiant peut créer un réseau
Lorsque l’université ne dispose pas du budget, du temps, des ressources ou de l'envie, ce sont les diplômés eux-mêmes qui peuvent prendre l'initiative. Par exemple, la future association des anciens et anciennes de science politique de l’université de Rouen, nommée ASPUR, illustre cette dynamique. Yousra Manaï, ancienne étudiante rouennaise aujourd'hui en poste à la mairie de Paris, est la future secrétaire de l’association : « Au départ, en 2020, alors que beaucoup d'entre nous avaient rencontré des difficultés pour trouver une place en master, nous avons eu l'idée de créer un tableau Excel regroupant nos noms, professions et contacts pour le faire circuler parmi les promotions suivantes. »
Aujourd'hui, ils s'efforcent de formaliser cette initiative sous la forme d’une association, « dans le but de créer du lien entre les promotions, mais aussi de rencontrer les étudiants, les guider dans leurs candidatures en master et les accompagner dans leur insertion professionnelle », précise Yousra Manaï. « N’importe quel étudiant peut se lancer pour créer un réseau », souligne Antoine Potor, futur président d'ASPUR et collaborateur parlementaire. « Il suffit de trouver deux ou trois personnes pour partager la charge et d’en parler avec l’équipe pédagogique de son diplôme. Ce type d’action peut aider à positionner l’université face aux écoles privées, qui font du réseau un argument de vente. Le réseau représente un capital que tous les étudiants n’ont pas en entrant à l’université. Les aider à le développer, c'est contribuer à leur insertion et à leur émancipation. » Une démarche à la fois utilitariste et politique.

SOURCE : LE PARISIEN

Nos réalisations
Découvrez nos références, nos réalisations et nos travaux pour des établissements.
C'est tout frais de nos experts

Coût des formations : comment l’outil P2CA va se déployer en 2026