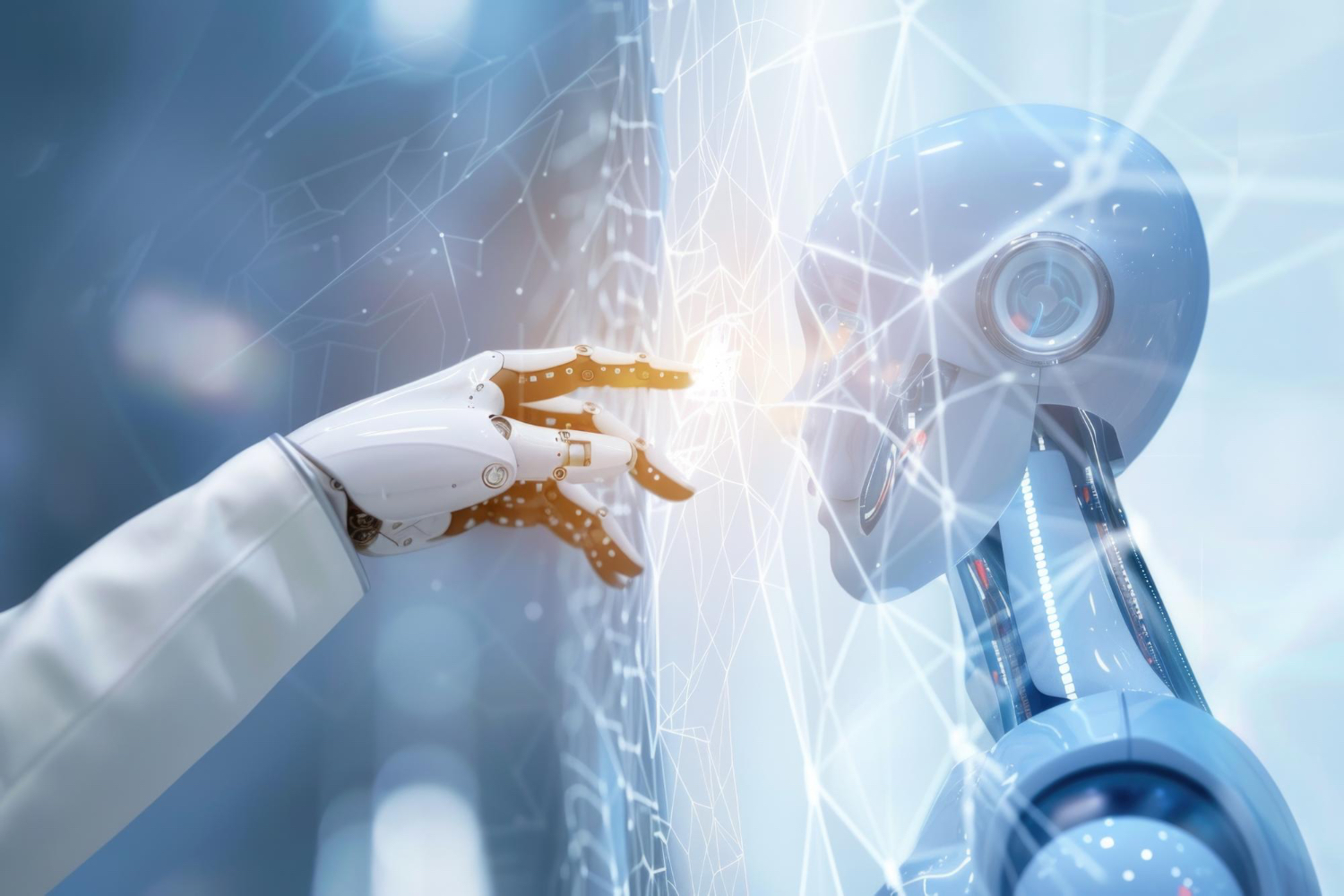L’entrepreneuriat étudiant : un levier pour la professionnalisation ? (Colloque de l'Avuf)

Incubateurs, Pépite, fablabs… Comment ces dispositifs d’accompagnement à l’entrepreneuriat s’intègrent-ils dans la professionnalisation des étudiants ? C’est la question centrale qui a animé la 10e conférence nationale des stages et actions de professionnalisation, organisée le 28 janvier 2025 par l’Avuf, en collaboration avec la Cdefi, la CGE et France Universités. Parmi les enjeux soulevés : l’objectif réel de ces initiatives, les défis liés à la collaboration entre étudiants d’horizons divers, la mesure des impacts à long terme et l’intérêt des entreprises pour ces dispositifs.
Entrepreneuriat et professionnalisation : un défi pour l’enseignement supérieur
Les universités accueillent une grande diversité d’étudiants et de formations, rendant l’intégration de l’entrepreneuriat un véritable défi. Pascale Brenet, présidente du réseau des vice-présidents en entrepreneuriat et directrice du Pépite Bourgogne-Franche-Comté, souligne que l’accompagnement entrepreneurial évolue, mais demeure complexe dans son organisation. Il peut être structuré à l’échelle des établissements, au sein des différentes composantes ou sous une approche plus transversale.
Du côté des écoles d’ingénieurs, l’entrepreneuriat est également structuré par les référentiels d’accréditation de la CTI, intégrant ces notions dans les parcours et diplômes d’ingénierie, rappelle Romain Laffont, directeur de Polytech Marseille et du Pépite Provence.
L’initiative Pépite, lancée en 2014, a marqué un tournant dans l’accompagnement des étudiants. Betty Teixeira, directrice du CAP Clermont Auvergne Pépite, précise que 5 861 jeunes ont été accueillis en 2023-2024, contre seulement 637 à sa création. Si ces pôles encouragent l’entrepreneuriat, leur but principal n’est pas tant la création d’entreprise que le développement de compétences clés, qu’elles soient techniques, analytiques ou managériales.
Créer des envies plutôt qu’imposer la création d’entreprise
L’enjeu premier de ces dispositifs est d’éveiller l’intérêt des étudiants, plutôt que de les pousser à créer immédiatement une entreprise, explique Dorothée Brette, responsable des Fablabs à CY Cergy Paris Université. Ces espaces d’expérimentation favorisent la créativité et permettent d’introduire des modules d’entrepreneuriat au sein des maquettes pédagogiques.
De même, l’IMT Starter, incubateur commun à Télécom SudParis et à l’IMT Business School, ne fixe pas d’objectifs de création d’entreprises aux étudiants. Son directeur, Sébastien Cauwet, insiste sur l’importance de l’apprentissage avant tout : "Ce qui compte, c’est qu’ils développent des compétences, pas forcément qu’ils montent une start-up."
Faciliter la collaboration entre ingénieurs et managers
L’un des défis majeurs des dispositifs d’entrepreneuriat réside dans la collaboration entre étudiants aux profils différents, notamment entre ingénieurs et managers. Sébastien Cauwet observe que certains ingénieurs ont tendance à se focaliser sur l’aspect technique, au détriment des compétences commerciales. "Ils pensent que la complexité technique prime, mais lorsqu’il faut décrocher un téléphone et négocier, c’est une autre histoire."
Cependant, ces interactions sont essentielles : l’entrepreneuriat crée des passerelles entre disciplines et favorise le travail en équipe. Des summer schools entrepreneuriales permettent ainsi aux étudiants d’écoles différentes de travailler ensemble sur des projets concrets, enrichissant leur apprentissage.
Mesurer l’impact des dispositifs entrepreneuriaux
Un autre enjeu soulevé lors du colloque est la difficulté à suivre l’impact de ces dispositifs sur le long terme. Pascale Brenet reconnaît qu’il existe un suivi à court terme des diplômés, mais qu’il reste complexe de mesurer l’évolution de leur carrière après plusieurs années.
Les dispositifs d’entrepreneuriat ne se limitent pas à la création d’entreprise immédiate. Ils influencent aussi des aspects tels que l’accès aux réseaux professionnels, l’épanouissement personnel et le développement de la confiance en soi. Selon Romain Laffont, les Pépite forment désormais des alumni, qui peuvent s’impliquer de différentes manières :
- Les jeunes diplômés, qui cherchent du soutien et des contacts.
- Les anciens étudiants, ayant quitté le dispositif depuis 10-15 ans et souhaitant devenir mentors ou intervenants.
- Les alumni expérimentés, qui, après 30 ans de carrière, peuvent soutenir les nouveaux entrepreneurs via du mécénat.
L’étude du Céreq de 2021 sur l’insertion des étudiants montre que ceux ayant suivi une formation en entrepreneuriat deviennent plus souvent indépendants et bénéficient d’une meilleure insertion professionnelle. Toutefois, Alexie Robert, chargée d’études au Céreq, s’interroge : "Ces effets positifs sont-ils liés à la formation ou au profil des participants ?" Une question qui mérite d’être approfondie.
Pourquoi l’entrepreneuriat intéresse-t-il les entreprises ?
Les entreprises perçoivent aujourd’hui l’entrepreneuriat comme un levier de développement territorial, de transmission et de formation de talents. Romain Laffont souligne que de plus en plus d’acteurs économiques encouragent ces dispositifs, voire créent leurs propres structures d’accompagnement.
Par exemple, CY Cergy Paris Université a lancé un diplôme universitaire (DU) de Fabmanager, destiné notamment aux collectivités souhaitant former des agents aux enjeux du numérique, ajoute Dorothée Brette.
En conclusion, l’entrepreneuriat ne se limite pas à la création d’entreprise : c’est avant tout une expérience professionnalisante, qui façonne des profils plus autonomes, polyvalents et prêts à s’adapter aux défis du monde du travail.

SOURCE : AEFINO

Nos réalisations
Découvrez nos références, nos réalisations et nos travaux pour des établissements.
C'est tout frais de nos experts

Coût des formations : comment l’outil P2CA va se déployer en 2026