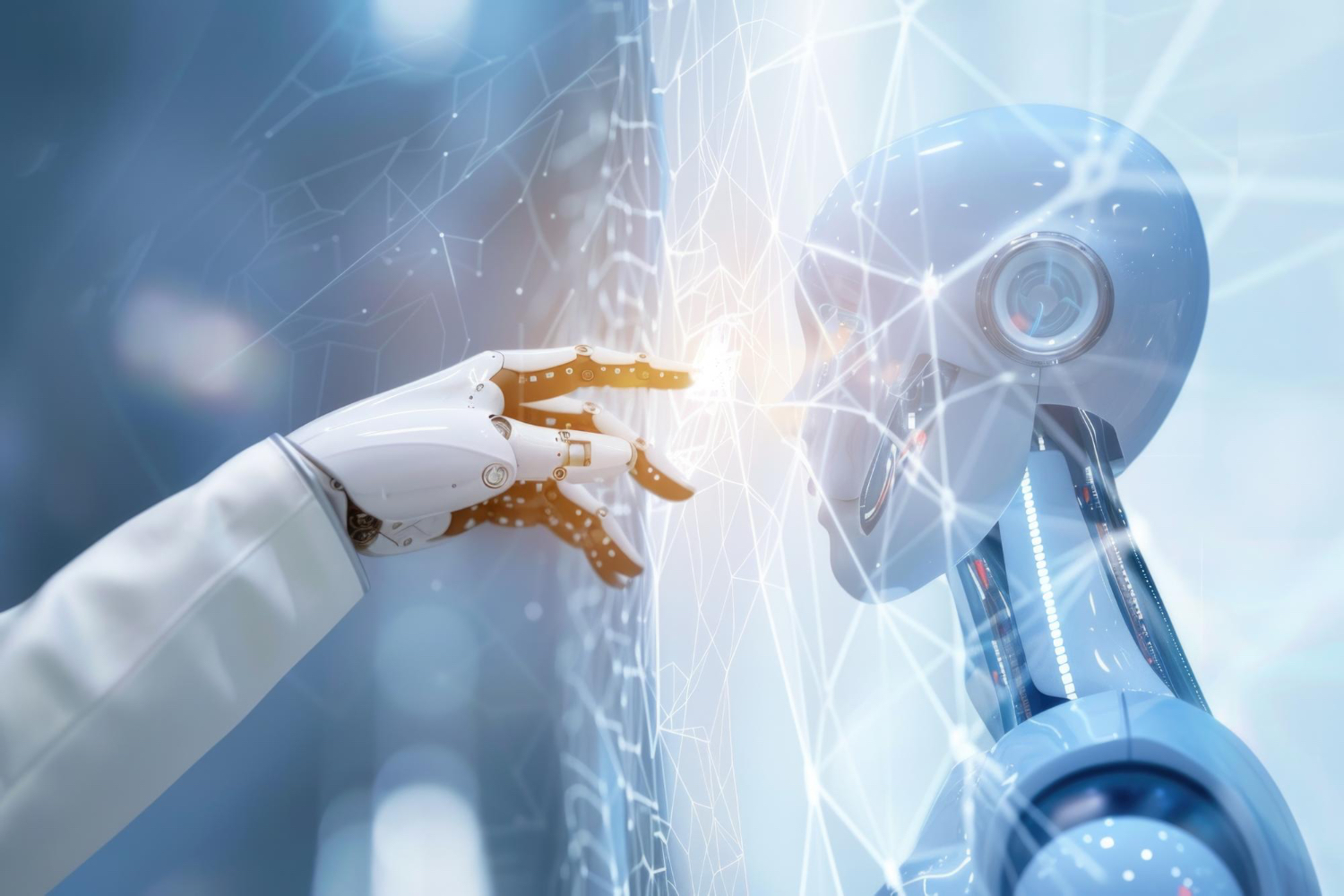Être chef d’établissement aujourd’hui

Rapport de l’inspection générale (IGESR), 09/2024
Ce rapport, fruit d’une étude menée auprès de 7 500 chefs d’établissement, se décline en trois parties principales :
- Qui sont les chefs d’établissement
- Les dispositifs de pilotage et d’animation
- Les missions qui leur incombent
L’inspection générale offre, en environ cinquante pages (soit 2h30 de lecture), un regard approfondi sur le métier. L’analyse repose sur des données statistiques ministérielles, une multitude d’entretiens et des journées d’immersion sur le terrain. Pour toute personne désireuse de comprendre les enjeux et la réalité du métier, ce rapport constitue une ressource incontournable.
Métier prescrit et métier réel
Les chefs d’établissement expriment un réel attachement à leur fonction, même si celle-ci les confronte quotidiennement à un volume de travail important, oscillant entre 50 et 60 heures par semaine. Ils se trouvent en première ligne pour assurer le bon fonctionnement de leur établissement, gérer les ressources humaines, développer des partenariats, mener la communication et mettre en œuvre la politique pédagogique et éducative. Cette multiplicité de responsabilités entraîne fréquemment une surcharge, particulièrement lorsque les équipes ne sont pas complètes – l’absence d’un(e) gestionnaire, d’un(e) adjoint(e), d’un(e) secrétaire de direction, d’un(e) conseiller principal d’éducation (CPE) ou d’un(e) infirmier(ère) est de plus en plus constatée.
Le rapport met en exergue, bien que cela ne soit pas une révélation, que la mise en place rapide de réformes peut fragiliser les relations avec les enseignants. De même, les interactions avec les parents se trouvent parfois teintées de méfiance, voire débouchent sur une judiciarisation accrue. Par ailleurs, la gestion des ressources humaines, notamment avec l’augmentation du recours aux contractuels, réduit le temps que les chefs peuvent consacrer au pilotage pédagogique. Ce fossé entre le métier tel qu’il est officiellement décrit et la réalité du terrain crée une tension importante : nombreux sont ceux qui se déclarent fatigués, voire proches de l’épuisement. Toutefois, le phénomène de « grande démission » ne semble pas se propager dans cette profession, puisque les ruptures conventionnelles concernent, sur 13 000 personnels de direction, seulement entre 20 et 30 cas ces dernières années.
Relations hiérarchiques et formations insuffisantes
Le rapport souligne la qualité des échanges avec le premier échelon hiérarchique (DASEN ou leur adjoint) qui, dans l’ensemble, apporte un soutien appréciable aux chefs d’établissement. En revanche, les interactions avec certains services du rectorat, notamment la division du personnel enseignant, restent souvent empreintes de formalisme et de bureaucratie.
Un autre point particulièrement préoccupant concerne la formation continue. Alors que les chefs d’établissement expriment un besoin réel d’accompagnement dans divers domaines – management, gestion budgétaire, aspects juridiques ou ressources humaines – ils ne bénéficient que de moins de trois jours de formation par an. De plus, plusieurs retours d’expérience font état d’un manque de transparence concernant les postes en mobilité, et d’une rémunération jugée insuffisante. Par ailleurs, la question de l’évolution professionnelle, qu’il s’agisse de passer vers d’autres fonctions, ministères ou d’envisager une troisième carrière, reste largement à l’initiative personnelle du chef d’établissement.
Un rapport riche mais quelques manques
Dans l’ensemble, l’inspection générale livre une analyse honnête et détaillée, n’hésitant pas à rapporter la parole des chefs d’établissement eux-mêmes. Parmi les points saillants, on retient notamment que, bien que le corps de direction soit de plus en plus féminisé, 63 % des proviseurs restent des hommes, même si la tendance évolue progressivement.
Cependant, trois axes d’amélioration sont relevés par les inspecteurs généraux :
- Absence de comparaisons internationales : Le rapport ne confronte pas les pratiques françaises à celles de grands pays européens, ce qui aurait permis de mesurer l’efficacité des dispositifs en place dans une perspective plus globale.
- Diversité des situations professionnelles : La diversité des contextes d’exercice – qu’il s’agisse d’un directeur de collège, d’un proviseur de lycée professionnel ou d’un chef d’établissement à la tête d’un grand établissement – n’est pas suffisamment prise en compte.
- Voix des adjoints et fonctionnement de l’équipe de direction : L’accent est trop souvent mis sur la figure du chef d’établissement, alors que les adjoints et la composition globale de l’équipe de direction mériteraient une attention particulière pour mieux comprendre le fonctionnement collectif.
Les inspecteurs optent pour l’expression « effet Direction » plutôt que « effet chef d’établissement », ce qui laisse entendre que le succès du pilotage dépend d’un collectif et non d’un seul individu.
Recommandations et perspectives d’avenir
Le rapport énonce une douzaine de recommandations visant à améliorer la pratique et l’attractivité de la fonction. Parmi celles-ci, quelques propositions retiennent particulièrement l’attention :
- Favoriser l’accès des femmes aux postes de direction les plus élevés : Une mesure qui contribuerait à une meilleure représentativité au sein des instances décisionnelles.
- Instaurer une formation continue attractive : Une démarche essentielle pour répondre aux nouveaux défis du métier et accompagner la montée en compétences.
- Actualiser le référentiel métier : Repenser et adapter le descriptif des fonctions afin de mieux correspondre à la réalité du terrain.
- Répartir la charge de travail au sein de l’équipe de direction élargie : Une meilleure distribution des responsabilités permettrait d’alléger la pression pesant sur le chef d’établissement.
- Créer un point d’entrée unique pour les chefs d’établissement dans chaque académie et à l’administration centrale : Cela faciliterait la communication et la coordination des actions.
Une recommandation particulièrement pertinente consiste à surclasser temporairement certains établissements en difficulté conjoncturelle afin de les rendre plus attractifs pour les chefs d’établissement expérimentés.
Conclusion
Pour l’inspection générale, les chefs d’établissement sont avant tout des cadres intermédiaires qui doivent jongler entre leur rôle de représentant loyal du ministère et celui de responsable autonome d’un établissement public local d’enseignement. Cette double casquette nécessite de maîtriser un ensemble de compétences variées – gestion, relationnel, aspects juridiques, pédagogiques et politiques.
Face à une attractivité en baisse – le nombre de candidats par poste ayant chuté de 5 à 3,61 entre 2021 et 2024 pour plus de 600 postes – il est crucial de :
- Maintenir et renforcer l’attrait de la fonction,
- Encourager le travail collectif pour lutter contre le sentiment d’isolement,
- Renforcer la formation continue ainsi que les passerelles vers d’autres emplois dans la fonction publique.
L’avenir de l’enseignement dépend en grande partie de la capacité à valoriser et à soutenir ces professionnels essentiels, dont l’expérience et le savoir-faire sont indispensables pour relever les défis de l’éducation d’aujourd’hui et de demain.

SOURCE : LINKEDIN

Nos réalisations
Découvrez nos références, nos réalisations et nos travaux pour des établissements.
C'est tout frais de nos experts

Coût des formations : comment l’outil P2CA va se déployer en 2026