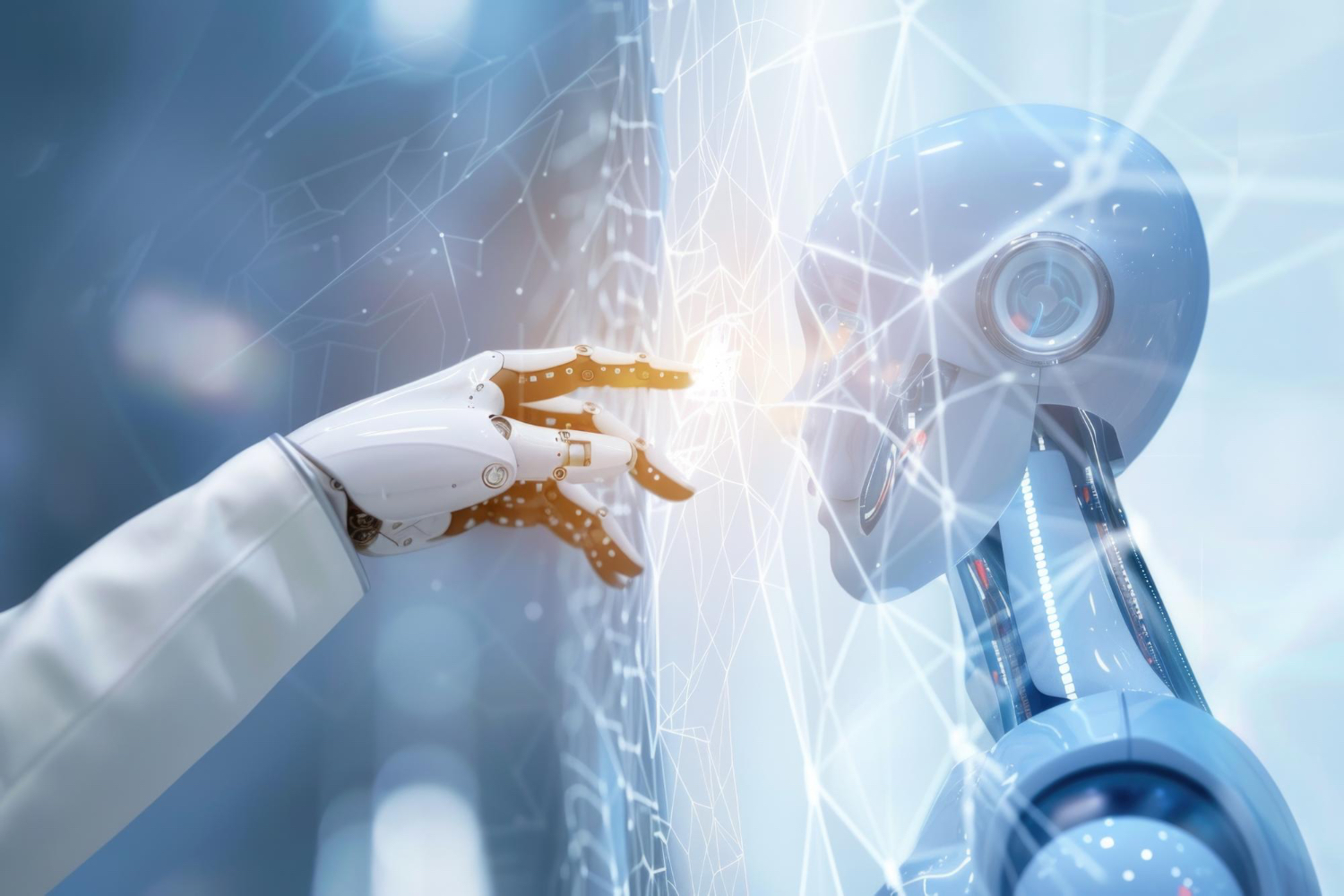Handicap : quelle inclusion scolaire à l'étranger ?

En septembre 2024, la Cour des comptes publiait un rapport sur l'inclusion scolaire, accompagné d'un cahier de comparaisons internationales. Ce document met en lumière les dispositifs mis en place en Allemagne, en Hongrie, en Italie, au Portugal, en Angleterre et en Suède, offrant ainsi une perspective sur la situation de nos voisins européens.
Alors que la loi du 11 février 2005 célèbre ses 20 ans, la Cour des comptes dresse un bilan qualifié de "contrasté" dans son rapport publié en septembre 2024 sur l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap.
Le texte de 2005, qui affirme le principe de scolarisation en milieu ordinaire pour tous les élèves, constitue la base de la politique d'inclusion scolaire. Si la Cour des comptes reconnaît "la pertinence et la cohérence" de cette politique publique, elle met toutefois en avant "des faiblesses dans la mise en œuvre".
Pour pallier ces lacunes, pourquoi ne pas s'inspirer des modèles étrangers ? Le cahier de comparaisons internationales permet d'explorer les dispositifs d'autres pays européens.
Les AESH dénoncent des conditions de travail de plus en plus difficiles
Le principe de l'inclusion totale : l'exemple italien
L'Italie est pionnière en matière d'école inclusive, ayant pris la décision, dès 1977, de fermer ses établissements spécialisés afin d'intégrer les élèves en situation de handicap dans les classes ordinaires.
Le système italien repose sur la création du métier d'enseignant de soutien. Cet enseignant spécialisé est affecté à la classe de l'élève en situation de handicap pour faciliter son intégration : "il n'est donc pas l'enseignant de l'élève handicapé, mais une ressource professionnelle affectée à la classe", explique le rapport.
Cependant, des débats persistent quant à la formation de ces enseignants. Beaucoup sont recrutés via des "listes de programmes" destinées à combler le manque de personnel qualifié et ne bénéficient donc pas d'une formation adéquate. "Au total, moins d'un enseignant de soutien sur trois est spécialisé et moins d'un sur quatre a suivi une formation sur l'inclusivité."
La question de la formation des enseignants
La formation des enseignants est également un enjeu majeur en Hongrie. Ce pays, marqué par une longue tradition de ségrégation dans l'enseignement, a amorcé une politique d'inclusion avec le changement de régime en 1989.
Néanmoins, le rapport souligne que les enseignants formés à l'éducation générale ne reçoivent pas de formation spécifique à l'inclusion. "Sans cette formation, ils rencontrent des difficultés non seulement pour gérer les problèmes quotidiens liés à l'enseignement des enfants ayant des besoins particuliers, mais aussi pour interpréter l'avis des experts en éducation spécialisée."
La situation est similaire en Allemagne, où une étude révèle que 89% des enseignants estiment ne pas avoir été "suffisamment" préparés à l'enseignement inclusif durant leur formation.
Des équipes mixtes et pluridisciplinaires
Depuis 2018, le Portugal a adopté une approche globale en matière d'inclusion scolaire, en abandonnant le système de catégorisation des élèves.
Chaque école dispose d'une équipe pluridisciplinaire chargée de soutenir l'éducation inclusive. Composée de l'enseignant de l'élève, de ses parents, d'un éducateur spécialisé et d'un psychologue, cette équipe propose et suit la mise en œuvre des mesures de soutien.
En Allemagne, une forte coopération existe entre l'école et le secteur médico-social. Pour chaque élève en situation de handicap, un plan d'intégration individuel est établi par les professionnels de l'éducation et du médico-social, en concertation avec les parents.
Par ailleurs, les écoles collaborent étroitement avec des professionnels de la santé (thérapeutes, médecins) afin de garantir une prise en charge adaptée aux besoins médicaux des élèves.
Handicap dans l'enseignement supérieur : une prise de conscience et des défis à relever
La coexistence d'établissements spécialisés
Comme en France, plusieurs pays ont conservé des établissements spécialisés qui viennent compléter les dispositifs d'inclusion scolaire. C'est notamment le cas de l'Angleterre, où des écoles spécialisées adoptent des pédagogies adaptées à quatre domaines : communication et interaction, cognition et apprentissage, santé mentale et émotionnelle, ainsi que les besoins physiques et sensoriels.
En Suède, certains établissements sont dédiés aux enfants avec un handicap physique "grave", mettant l'accent sur la langue et la communication. D'autres sont spécialisés pour les sourds et malentendants.
Toutefois, des dispositifs spécialisés existent aussi au sein des écoles ordinaires ou spécialisées. C'est le cas des "groupes d'enseignement spécial" et des classes d'éducation spécialisée pour les élèves ayant des déficiences intellectuelles sévères, un modèle qui rappelle les Ulis (unités localisées d'inclusion scolaire) en France.

SOURCE : L'ÉTUDIANT

Nos réalisations
Découvrez nos références, nos réalisations et nos travaux pour des établissements.
C'est tout frais de nos experts

Coût des formations : comment l’outil P2CA va se déployer en 2026