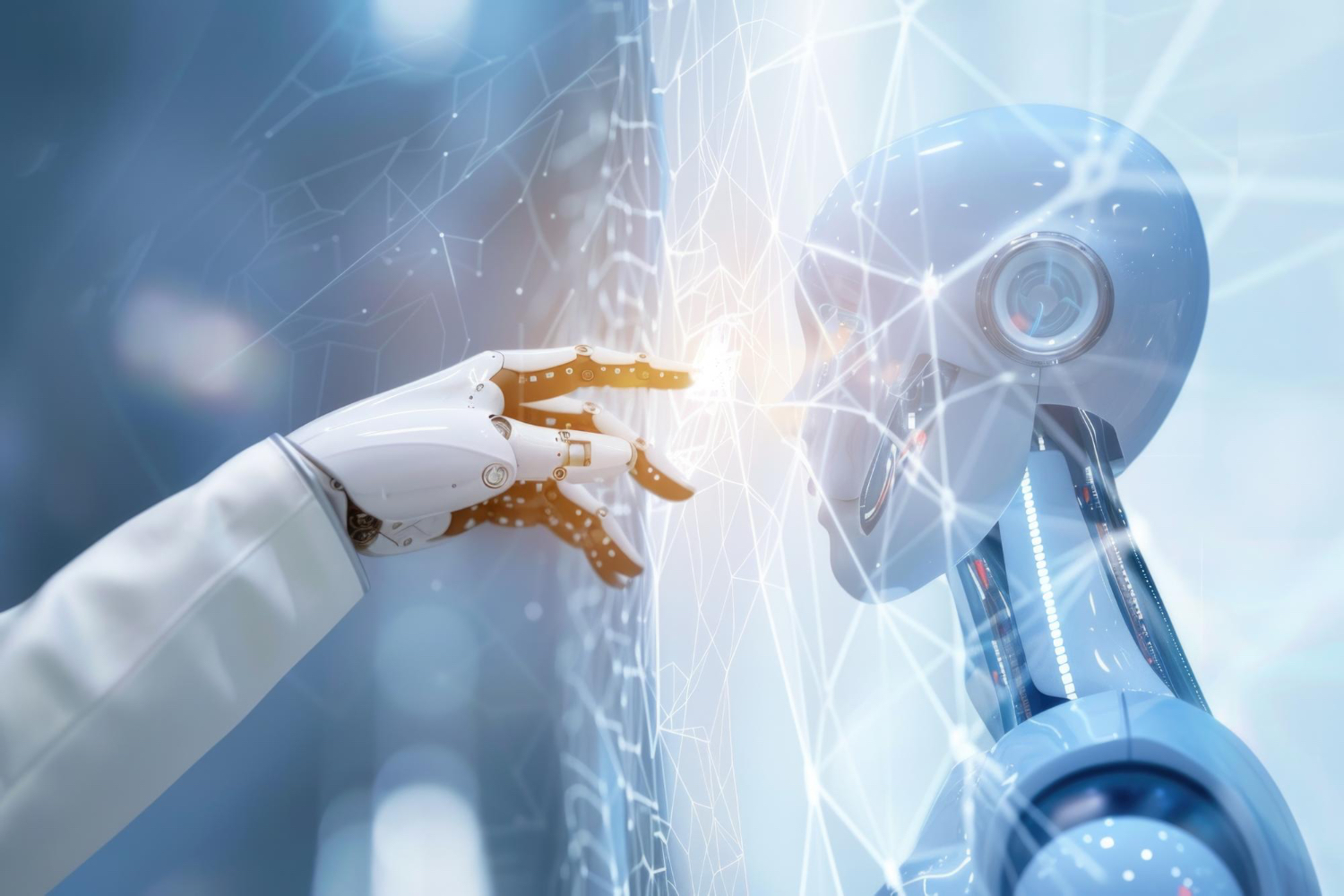L’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap : un enjeu à renforcer

L'inclusion scolaire a pour objectif d'assurer une éducation de qualité à tous les élèves en tenant compte de leurs spécificités et de leurs besoins particuliers. Depuis la loi du 11 février 2005 sur l'égalité des droits des personnes handicapées, la scolarisation des élèves en situation de handicap dans des établissements scolaires classiques est devenue un principe de droit en France. Depuis cette loi, le nombre d’élèves concernés a triplé, passant de 155 361 en 2006 à 436 085 en 2022. Si, en termes de nombre, le système scolaire a évolué, les parcours des élèves et de leurs familles restent complexes, notamment en ce qui concerne l’information sur les dispositifs disponibles, les transitions entre le milieu scolaire classique et le secteur médico-social, l’orientation scolaire, ou encore l’insertion professionnelle. Une évaluation menée en 2022 s'est penchée sur le parcours de ces élèves depuis la maternelle jusqu’au lycée, aboutissant à quatre messages principaux.
1. Améliorer la gestion et l’évaluation de la politique publique
Bien que des progrès aient été réalisés, la politique de scolarisation des élèves en situation de handicap souffre encore d’une coordination insuffisante entre le secteur éducatif et le secteur médico-social. Par ailleurs, les décisions des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) concernant l’orientation en établissements spécialisés ne sont pas toujours mises en œuvre, forçant les établissements scolaires à accueillir des élèves avec des besoins complexes, face auxquels les enseignants se sentent parfois démunis. La politique d’inclusion manque également de données fiables pour évaluer son efficacité, notamment en ce qui concerne l'impact sur la réussite scolaire des élèves handicapés. Il est donc difficile de juger les performances du modèle français d’inclusion scolaire.
2. Optimiser l'utilisation des outils d'accessibilité et de compensation
Deux approches principales sont utilisées pour répondre aux besoins des élèves handicapés : l'accessibilité et la compensation. L'accessibilité consiste à garantir que tous les jeunes aient accès aux savoirs dans une école proche de chez eux, les collectivités territoriales étant responsables de rendre les infrastructures scolaires accessibles. Cependant, une planification insuffisante des besoins persiste. Quant à la compensation, elle permet de mettre en place des mesures individuelles, comme l’accompagnement par des AESH (Accompagnants d’élèves en situation de handicap), qui est devenu une composante majeure du système éducatif, au détriment d’outils d’accessibilité qui restent insuffisants.
3. Renforcer la gestion des ressources humaines dédiées à l’inclusion
Les enseignants et les AESH ressentent souvent un manque de préparation face à la diversité des situations rencontrées. Ils demandent plus de formation initiale et continue, ainsi que l’aide de spécialistes des secteurs médico-sociaux. Les enseignants spécialisés mériteraient également une meilleure valorisation, et l’attractivité de la formation spécialisée (CAPPEI) doit être renforcée. Il manque aussi un cadre clair pour définir le rôle des AESH et améliorer leurs conditions de travail. Un référentiel professionnel serait souhaitable pour garantir l’efficacité de leur accompagnement.
4. Simplifier le parcours des élèves et de leurs familles
Les familles décrivent souvent la scolarisation de leur enfant comme un « parcours du combattant », avec des démarches répétitives auprès des MDPH. Il est essentiel de mieux coordonner l’accueil entre le milieu scolaire classique et le secteur médico-social pour offrir un parcours inclusif global. En l’absence de la généralisation du Livret de parcours inclusif, les outils pour suivre et orienter les élèves handicapés durant leur scolarité, puis vers l’enseignement supérieur ou l’insertion professionnelle, sont insuffisants. Ces lacunes se traduisent par des parcours discontinus pour beaucoup d'élèves, générant un mal-être et de l’incertitude quant à leur avenir. Le taux de chômage des personnes en situation de handicap reste deux fois plus élevé que celui des autres actifs (12 % contre 7 % en 2022), illustrant les limites du système de formation actuel à offrir des chances égales à tous.
Version FALC : En parallèle du rapport, la Cour des comptes propose une version en FALC (Facile à Lire et à Comprendre), conçue pour rendre le contenu accessible aux personnes ayant des difficultés de compréhension, en particulier les personnes handicapées mentales.
SOURCE : CCOMPTES

Nos réalisations
Découvrez nos références, nos réalisations et nos travaux pour des établissements.
C'est tout frais de nos experts

Coût des formations : comment l’outil P2CA va se déployer en 2026