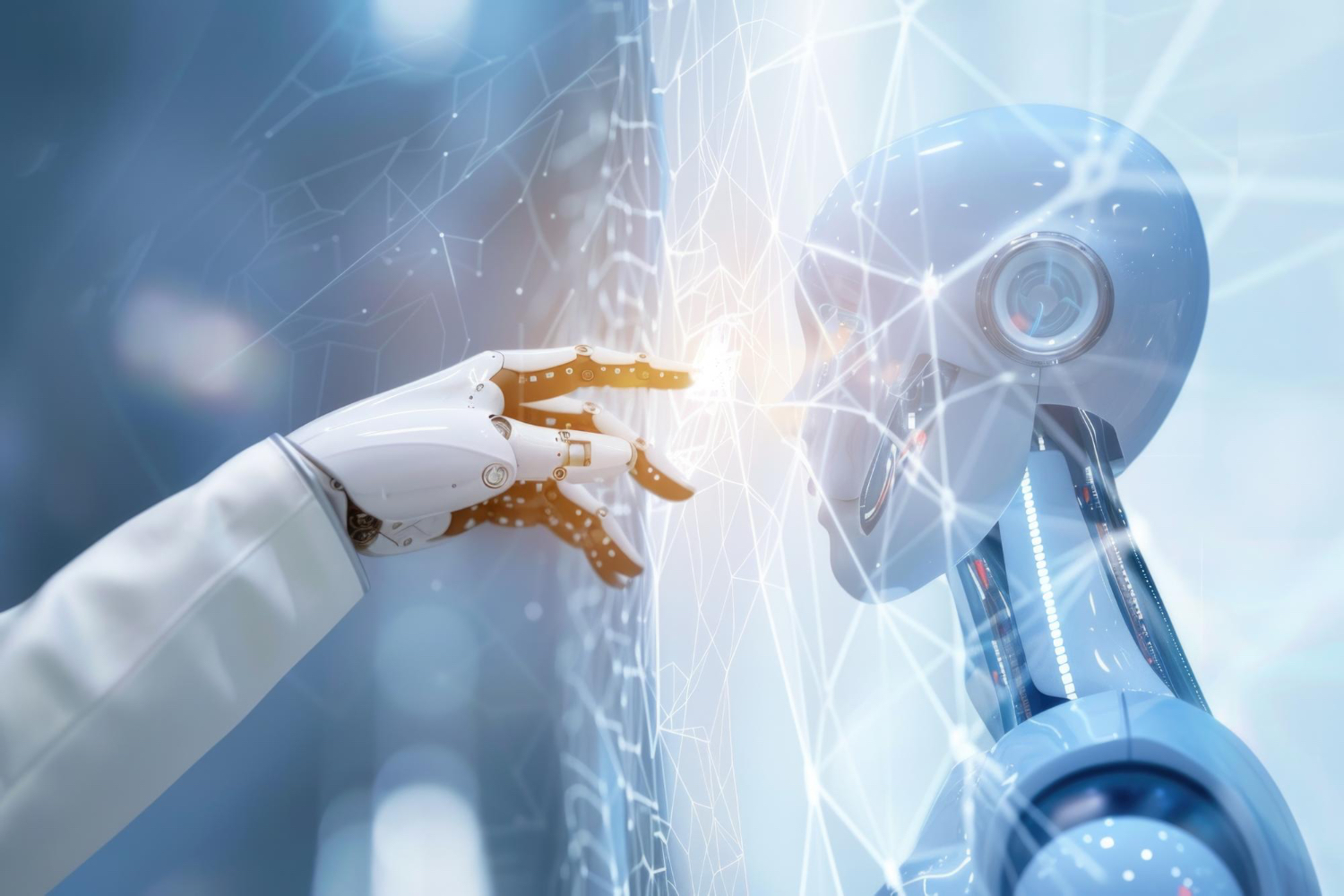Intelligence artificielle et éducation : pour un avenir lucide, pas naïf

Par Charles Largement, Président-Fondateur d’Ekole
Nous y sommes.
En 2023, on parlait de ChatGPT comme d’un gadget de salon. En 2024, on a commencé à en tester les usages dans quelques classes. En 2025, on ne peut plus faire semblant : l’intelligence artificielle est entrée dans le quotidien de l’école française.
Elle est là, dans les plateformes adaptatives. Dans les corrections automatisées. Dans les tuteurs numériques comme MIA Seconde. Dans les projets soutenus par France 2030. Elle est là, aussi, dans les débats houleux des conseils pédagogiques, dans les inquiétudes des enseignants, et dans les attentes silencieuses des élèves.
La vraie question n’est donc plus “Faut-il intégrer l’IA dans l’éducation ?”, mais : “Comment le faire de manière juste, humaine et éclairée ?”
Un changement de paradigme
L’IA ne remplace pas l’école. Mais elle la reconfigure. Elle transforme notre rapport au savoir, à la temporalité, à l’erreur, à l’évaluation. Et elle oblige chaque établissement à se poser des questions fondamentales : sur sa mission, sa méthode, sa promesse.
Car intégrer l’IA, ce n’est pas juste “numériser” des pratiques. C’est accepter de remettre à plat certaines logiques profondément ancrées dans notre culture scolaire.
Ce que l’IA change (déjà) dans l’expérience éducative
1. L’émergence d’un apprentissage sur mesure
Les plateformes adaptatives basées sur l’IA analysent les performances des élèves en temps réel. Elles identifient les faiblesses, ajustent les exercices, modulent le rythme.
En théorie, c’est une avancée majeure pour la différenciation pédagogique. En pratique, cela suppose que l’enseignant garde le contrôle, filtre, valide, et contextualise.
"MIA Seconde", le tuteur IA lancé par l’Éducation nationale, est un bon exemple : il ne remplace pas le professeur, il complète son action — à condition que ce dernier soit formé et accompagné.
— Le Monde, octobre 2024
2. Une charge mentale qui peut diminuer… ou exploser
La correction automatique, les tableaux de bord d’analyse, les prédictions sur les risques de décrochage : autant d’outils qui peuvent soulager les équipes éducatives.
Mais lorsqu’ils s’ajoutent, sans cadre clair ni formation adaptée, ils deviennent contre-productifs. Le gain de temps promis se transforme en surcharge cognitive.
En 2025, 80 % des enseignants français ne sont pas formés à l’IA. Et seulement 20 % d’entre eux l’utilisent réellement dans leurs pratiques, selon l’étude GoStudent (janvier 2025).
Ce que l’IA ne pourra jamais remplacer
Elle peut imiter le langage. Prédire des erreurs. Générer un corrigé. Mais elle ne peut pas :
- Repérer un regard fuyant
- Saisir un silence signifiant
- Accompagner un élève en souffrance
- Faire grandir une intuition
- Créer une relation de confiance
L’école n’est pas un tableau de bord. Elle est un espace de lien, de construction de soi, d’apprentissage du vivre-ensemble. L’IA est un outil. L’enseignant est un repère.
Les défis : techniques, éthiques, politiques
1. L’équité
En 2025, seuls 24 % des élèves français ont accès à des outils d’IA en classe. Ils sont 44 % en Italie, 36 % en Allemagne. Le risque est là : que l’IA creuse un peu plus les inégalités déjà existantes.
Source : GoStudent, "Statistiques sur l’IA dans l’éducation", 2025
2. Les biais algorithmiques
L’IA n’est pas neutre. Elle hérite des biais des données qui la nourrissent. Si l’on n’y prend pas garde, on risque d’automatiser des inégalités au lieu de les corriger.
“La transparence des algorithmes utilisés dans l’éducation doit devenir une exigence démocratique.”
— INAES (Institut national pour l’évaluation et la sécurité de l’intelligence artificielle), rapport 2025
3. La gouvernance des données
À qui appartiennent les données des élèves ? Comment sont-elles stockées ? Pour quel usage secondaire ? La question du RGPD est loin d’être réglée dans les faits.
Ce que nous défendons chez Ekole
Nous ne sommes ni technophiles béats, ni technophobes de principe. Nous croyons que l’IA peut enrichir l’éducation, mais seulement si :
- Elle est maîtrisée par les équipes éducatives
- Elle libère du temps pour le lien humain
- Elle respecte l’autonomie des enseignants
- Elle renforce la personnalisation sans déshumaniser
Concrètement, cela suppose :
- Des phases de test progressif, pas de déploiement brutal
- Un pilotage local avec retour d’expérience partagé
- Une formation systémique (enseignants, direction, vie scolaire)
- Une réflexion sur l’image et la promesse éducative de l’établissement à l’ère de l’IA
Ce que nous proposons
Chez Ekole, nous accompagnons les établissements dans leur transition numérique — pas seulement d’un point de vue technologique, mais stratégique et humain.
Nous développons des démarches sur-mesure :
- Diagnostic IA & communication : Où en êtes-vous ? Qu’attendent vos équipes ? Vos familles ? Vos élèves ?
- Formations pour les équipes éducatives : Comprendre, tester, décider.
- Stratégie de marque à l’ère numérique : Comment positionner votre établissement dans un monde où l’IA est partout… sauf dans le regard ?
En conclusion : l’IA est un révélateur
Elle révèle ce qu’on veut transmettre. Elle amplifie les logiques en place. Elle oblige à poser les bonnes questions.
Ce n’est pas l’IA qu’il faut craindre. C’est l’absence de vision sur ce qu’on veut en faire.
Et cette vision, c’est à nous, éducateurs, chefs d’établissement, communicants, de la construire ensemble.
Sources citées
- Le Monde – MIA Seconde : le tuteur IA de l'Éducation nationale est-il déjà obsolète ?, octobre 2024
- Ministère de l’Éducation nationale – IA et éducation : mesures 2025, février 2025
- GoStudent – Statistiques IA dans l’éducation en France, janvier 2025
- INESIA – L’IA dans les systèmes éducatifs : rapport annuel, mars 2025
- Education.gouv.fr – Appel à projets France 2030 : IA et école, avril 2025


Nos réalisations
Découvrez nos références, nos réalisations et nos travaux pour des établissements.
C'est tout frais de nos experts

Coût des formations : comment l’outil P2CA va se déployer en 2026