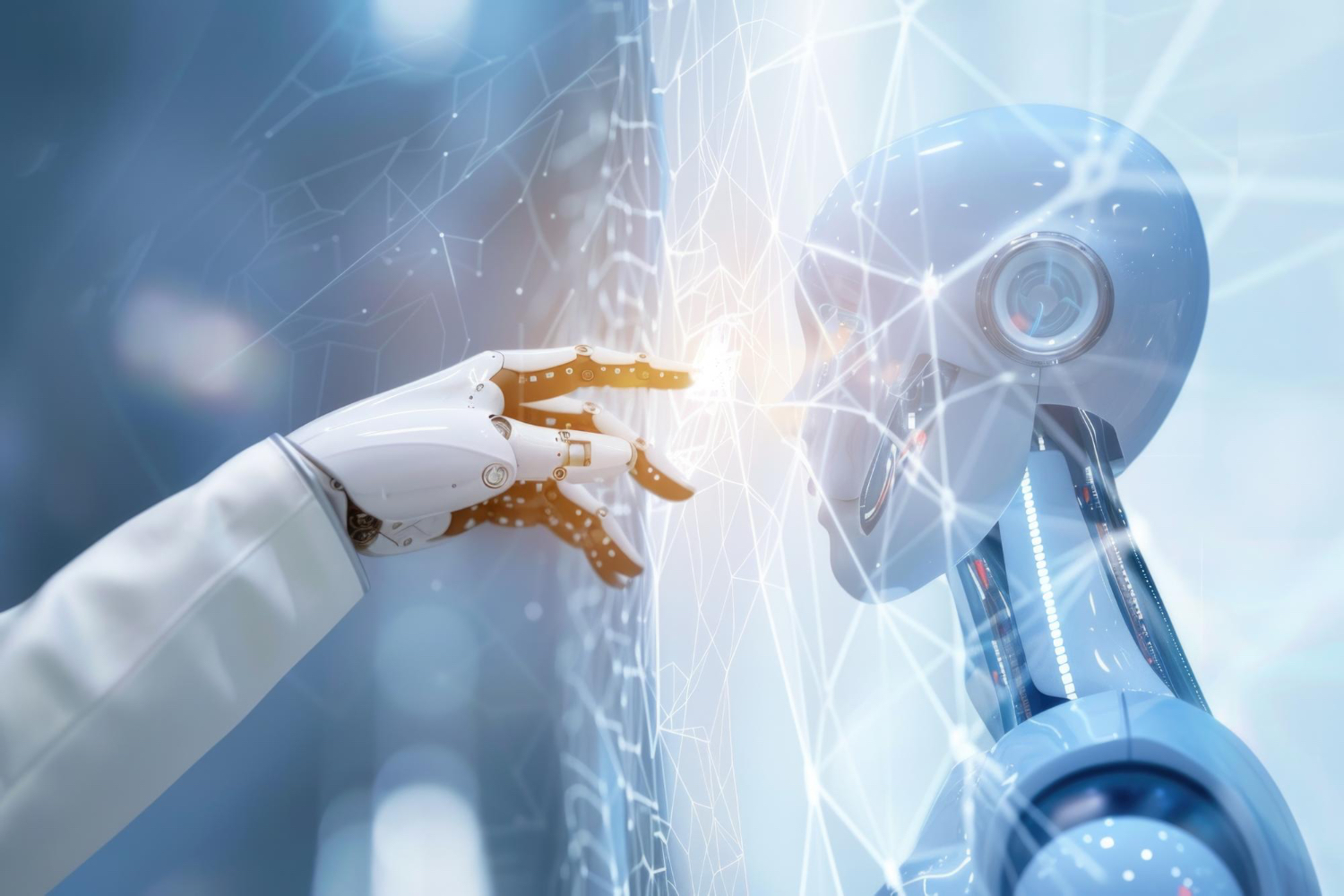L'internationalisation des formations : faut-il pour cela enseigner en anglais ?

Le 12 janvier 2024, Emmanuel Macron a prononcé un discours en anglais à l’Université Humboldt de Berlin, citant la nécessité de faciliter la compréhension. Cette décision a suscité des réactions vives, notamment de l’Observatoire européen du plurilinguisme, qui a suggéré que d'autres langues comme le français ou l'allemand auraient été plus appropriées dans ce contexte.
La Journée européenne des langues, célébrée chaque septembre, invite à réfléchir sur le rôle de l'anglais, mais aussi sur celui des autres langues dans l'internationalisation des formations.
Pour attirer des étudiants internationaux et offrir des opportunités de carrière à l'étranger, de plus en plus d’établissements supérieurs proposent des cours en anglais. Cependant, est-ce suffisant pour internationaliser réellement les formations ? Quel est l’impact de la maîtrise d’autres langues étrangères ?
L’anglicisation des formations : une solution efficace ?
Lorsqu'on parle d'internationalisation des formations, on pense souvent à permettre des séjours à l’étranger via des programmes comme ERASMUS et à dispenser des cours en anglais. L'« English as a Medium of Instruction » (anglais comme langue d'enseignement) est souvent perçu comme une clé pour internationaliser les cursus.
Dans de nombreuses universités françaises, l'anglais est parfois la seule langue étrangère proposée. En 2020, Emmanuel Macron avait envisagé une certification obligatoire en anglais pour les étudiants de licence, mais cette mesure a été annulée par le Conseil d’État deux ans plus tard pour des raisons juridiques, non liées à la politique linguistique.
Selon François Grin, professeur à l’Université de Genève, l’internationalisation est souvent confondue avec anglicisation, notamment dans les pays non anglophones. Les avantages perçus de l'anglicisation incluent une facilitation des échanges et une attraction accrue des étudiants. Cependant, cette orientation peut entraîner des effets négatifs à long terme, comme l’uniformisation des approches pédagogiques et la diminution de l’influence de la recherche francophone.
Une alternative plurilingue bénéfique
Pour une véritable internationalisation, la promotion du plurilinguisme semble être une option plus pertinente. En Suisse, la maîtrise des langues étrangères, dont l’anglais, est valorisée sur le marché du travail, offrant des avantages tels que des opportunités de carrière accrues et des salaires plus élevés. Bien que le contexte suisse soit unique, il illustre une tendance générale : la connaissance de plusieurs langues est un atout précieux.
Des langues comme l’allemand et l’espagnol sont particulièrement recherchées en France. Par exemple, le Groupe d’étude et de recherche en espagnol de spécialité (GERES) souligne l'importance de l’espagnol pour les échanges commerciaux avec l’Espagne.
L’apprentissage de langues étrangères va au-delà de la simple compétence linguistique ; il constitue un outil de développement personnel et favorise l’ouverture culturelle. Jean-Paul Narcy-Combes et Claire Chaplier expliquent que les expériences pluriculturelles enrichissent les individus en leur permettant d'interagir et de comprendre différentes cultures, contribuant ainsi au vivre ensemble.
Le cas de la Lorraine : une approche régionale
La Lorraine, avec ses frontières avec la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne, illustre bien les enjeux linguistiques. L’Académie de Nancy-Metz et l’Université de Lorraine mettent en place des mesures pour soutenir les langues régionales tout en faisant face à la demande croissante pour les cours en anglais.
L’Université de Lorraine a été pionnière en créant en 2014 une composante dédiée aux Langues pour les Spécialistes d’Autres Disciplines (LANSAD), offrant aux étudiants des ressources pour personnaliser leur apprentissage des langues. Plus récemment, l’INSPÉ de Lorraine a lancé une Maison pour les langues pour renforcer les opportunités de formation continue des enseignants.
En conclusion, l’internationalisation des formations ne se limite pas à l’anglicisation. Pour être réellement efficace, elle doit intégrer une politique linguistique réfléchie, basée sur la recherche et adaptée aux spécificités régionales. Une telle approche permettra de répondre aux défis actuels tout en valorisant la diversité linguistique.

SOURCE : THE CONVERSATION

Nos réalisations
Découvrez nos références, nos réalisations et nos travaux pour des établissements.
C'est tout frais de nos experts

Coût des formations : comment l’outil P2CA va se déployer en 2026