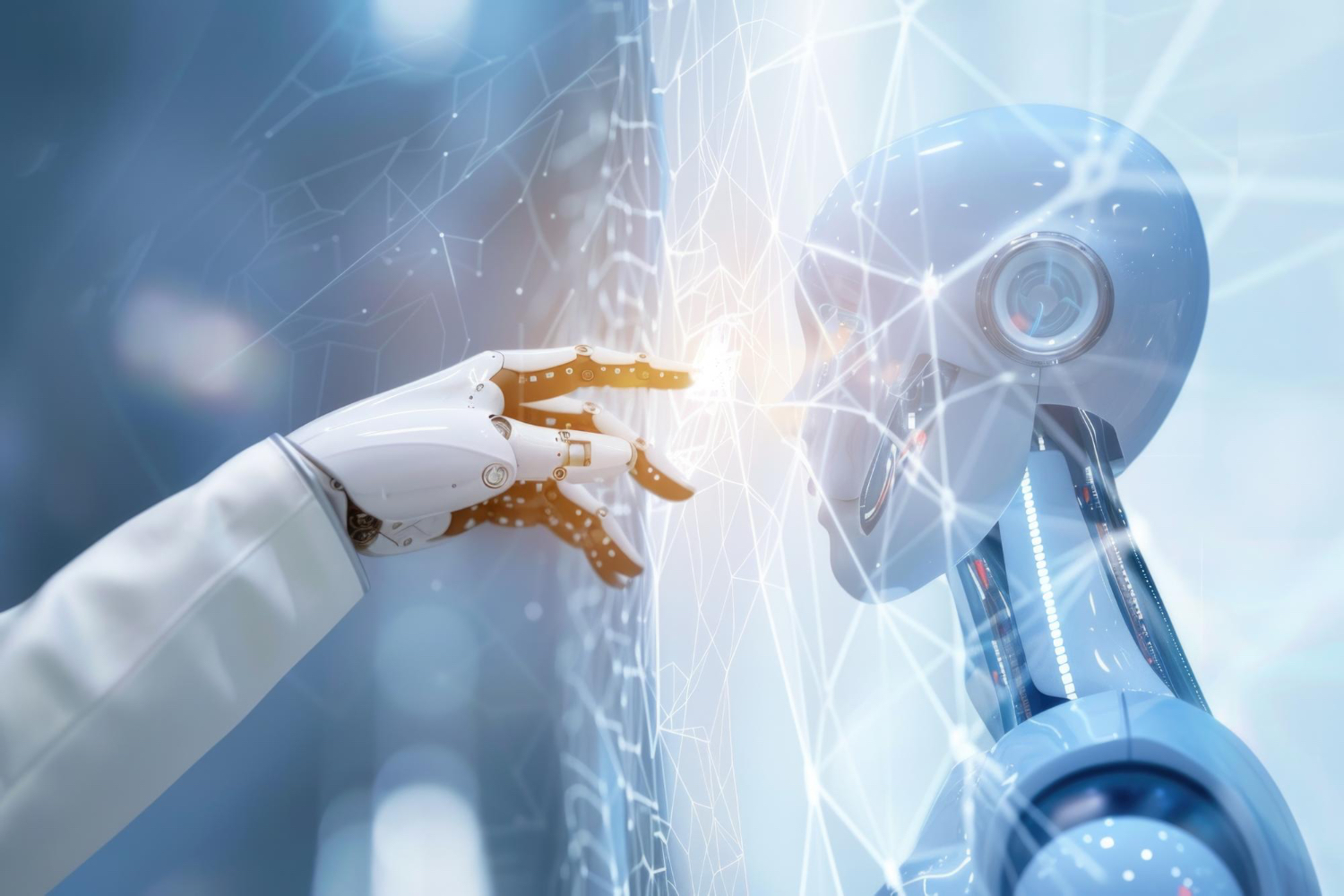La langue des signes à l’école : 50 ans de luttes et de progrès

Bien que la langue des signes française (LSF) soit reconnue comme langue d’enseignement depuis 2005, l’accès à un cursus bilingue LSF-français demeure compliqué.
Depuis 2005, la loi sur l’accessibilité permet aux parents de choisir la langue de scolarisation de leur enfant sourd. En théorie, ils peuvent demander un cursus bilingue en LSF et français. Cependant, les structures offrant ce type d’enseignement restent rares, ce qui complique les démarches de rentrée pour les familles.
La reconnaissance de la LSF comme langue d’enseignement et d’apprentissage est le résultat d’un long processus amorcé dans les années 1970. Revenons sur 50 ans de luttes et de progrès.
L’hégémonie de la parole
Jusqu’aux années 1970, les sourds subissaient l’interdiction de la langue des signes dans les institutions spécialisées, l’oralisation étant privilégiée dans les écoles. Ce statut d’élève handicapé, perçu avant tout comme « non-entendant », découle de l’histoire répressive des signes utilisés par les sourds, en particulier après le Congrès de Milan en 1880. Ce congrès a marqué le paroxysme du conflit entre manualistes, qui défendent l’usage des signes, et oralistes, qui considèrent la parole comme le seul vecteur de langage et de pensée.
Cette hégémonie de la parole a perduré jusqu’aux années 1970. L’enfant sourd était vu comme un enfant à rééduquer, manquant d’audition, de langage, d’intelligence ou d’affectivité. La prohibition des gestes était si stricte qu’elle conduisait parfois à attacher les mains des enfants pour ne pas entraver leur rééducation vocale.
À partir des années 1970, le sociologue français Bernard Mottez et le sociolinguiste américain Harry Markowicz se sont battus pour rendre visible la communauté sourde et pour faire prendre conscience aux sourds qu’ils forment une communauté linguistique. Grâce à des rencontres internationales, des ateliers et la création d’associations, les sourds ont réalisé qu’ils parlaient une langue visuo-gestuelle, désormais désignée comme la « langue des signes française », lui donnant ainsi une identité linguistique propre.
Pour Bernard Mottez, il est essentiel que les sourds réinvestissent la langue dont ils avaient été dépossédés au profit du handicap. Jusqu’aux années 1980, le discours autour de la parole des sourds se résumait à des termes comme « langue mimique », « langage gestuel », ou « sourds-muets ». Ces différentes appellations traduisent un rapport dévalorisant à la langue orale.
« Le Réveil Sourd »
Dans les années 1970 et 1980, sourds et entendants, parents et professionnels se sont unis pour revendiquer la langue des signes auprès des autorités. Ces actions s’inscrivent dans le mouvement « Le Réveil Sourd », qui a permis de faire connaître la langue des signes et ses locuteurs.
Parmi les nombreuses revendications, deux ont conduit à la loi actuelle : la reconnaissance de la LSF comme langue et le droit à l’éducation bilingue (LSF et français écrit). En 1984, la première classe bilingue « sauvage » ouvre à Poitiers, ce modèle se répand dans plusieurs villes et obtient progressivement un statut officiel. La loi Fabius du 18 janvier 1991 mentionne timidement la LSF en tant qu’option possible : « Dans l’éducation des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue – langue des signes et français – et une communication orale est de droit ».
Cependant, cette loi ne sera pas suivie de décrets d’application, et la présence de la LSF dans l’éducation continuera à évoluer lentement jusqu’à la loi du 11 février 2005, qui lui conférera un premier statut officiel : « Dans l’éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue, langue des signes et langue française, et une communication en langue française est de droit ».
Le choix de la scolarisation
Les parents ont désormais la possibilité de choisir le parcours scolaire de leur enfant, avec la LSF comme langue principale, sans exclure l’oralisation qui peut être proposée en dehors de l’école, et sans obligation d’évaluation.
Depuis cette loi, plusieurs circulaires ont été émises pour améliorer la scolarisation des enfants sourds. Par exemple, la circulaire PEJS de 2017 (Pôle d’enseignement pour les jeunes sourds) affiner les programmes scolaires selon les choix de parcours.
Cependant, ces textes ne reflètent pas toujours la réalité ni le combat des parents pour que leur enfant ait accès à la langue des signes. Pour ceux qui optent pour cette langue, le parcours est souvent long, complexe et parfois mal compris.
Bien que les parents reçoivent des informations sur les différents types d’appareillage et les implants cochléaires, ils manquent d’informations concernant la LSF : sa structure grammaticale, comment l’apprendre, la communauté sourde et ses actions pour défendre les droits des sourds.
Ces parents doivent alors rechercher eux-mêmes des contacts d’associations qui pourraient les aider dans l’apprentissage de cette nouvelle langue et la découverte de ce nouveau monde.
Ce cheminement se déroule parallèlement à l’acceptation de la surdité. L’annonce de celle-ci, pour des parents entendants, est souvent brutale et soulève des interrogations profondes : comment vais-je communiquer avec mon enfant ?
Selon le degré de surdité (sévère, moyenne, profonde), l’âge de la surdité (à la naissance ou après deux ans), et la nature de la surdité (transmission, perception, acquise ou progressive), l’accompagnement varie.
Appareillage et rééducation
La rééducation et les propositions d’appareillage sont généralement les premiers éléments présentés aux parents, avec l’idée que l’enfant sourd doit se rapprocher le plus possible de l’enfant entendant. Selon le corps médical, il s’agit de « la réponse la plus logique à la surdité ».
Cette promotion des appareillages survient alors que les parents vivent un moment difficile. La psychothérapeute Elisabeth Zinschitz souligne que « la réaction des parents varie en fonction de paramètres individuels, mais on constate chez chacun d’eux que tout un univers s’effondre ». Pour les enfants souffrant d’une surdité sévère ou profonde avant l’âge de deux ans, le processus de rééducation peut être long et peu efficace. La langue des signes est parfois proposée comme langue d’appui pour accéder au français oral, « comme une langue tremplin, moins considérée comme une langue à part entière que comme un outil vers le français vocal », selon la sociolinguistique Pauline Rannou.
Les parents se retrouvent alors entraînés dans une spirale médicale et rééducative sans que la langue des signes ne leur soit présentée comme une langue accessible et naturelle, qu’ils peuvent apprendre comme n’importe quelle autre langue.
Bien que la surdité soit une déficience, elle permet aussi d’être locuteur de la langue des signes, qui répond à toutes les fonctions langagières. Les parents doivent avoir le choix de la langue de leur enfant dès le dépistage de la surdité, en étant pleinement informés que l’appareillage n’exclut pas l’apprentissage de la langue des signes et vice versa.

SOURCE : THE CONVERSATION

Nos réalisations
Découvrez nos références, nos réalisations et nos travaux pour des établissements.
C'est tout frais de nos experts

Coût des formations : comment l’outil P2CA va se déployer en 2026