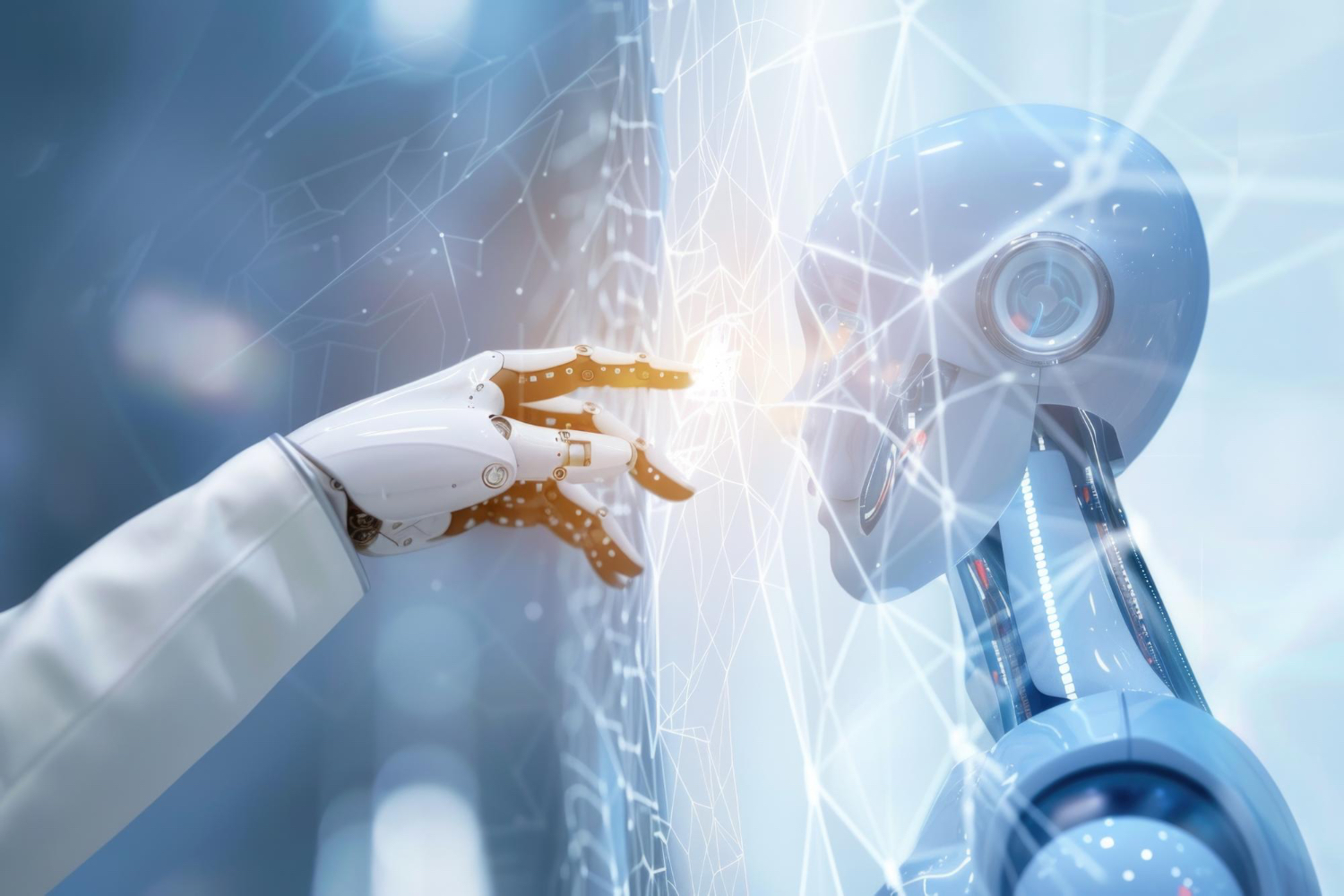L'Afrique ne manque pas d'universités mais d'infrastructures de recherche

À l'occasion d'un forum sur la transformation des savoirs en Afrique, Stefania Giannini, sous-directrice générale de l'Unesco pour l'éducation, revient sur les défis à relever pour accélérer la recherche.
Du 30 septembre au 2 octobre, le siège de l'Union africaine à Addis-Abeba a accueilli le forum "Transformer les savoirs pour l'avenir de l'Afrique", coorganisé par la Commission de l'Union africaine et l'Unesco. L'objectif était de changer de paradigme, alors que moins de 1 % de la recherche scientifique mondiale provient du continent. Le forum a notamment mis l'accent sur les chaires de l'Unesco, un réseau mondial d'universités soutenant l'institution onusienne dans ses domaines de compétence – éducation, sciences exactes et naturelles, sciences sociales, culture et communication – pour relever les grands défis actuels et contribuer au développement des sociétés.
En marge de l'événement, Stefania Giannini détaille les obstacles et la stratégie pour accélérer la recherche en Afrique.
Pourquoi transformer les savoirs est-il essentiel pour l'avenir de l'Afrique ?
Stefania Giannini : La connaissance peut permettre à l'Afrique de jouer à nouveau un rôle de premier plan. La diversité culturelle, avec son riche patrimoine matériel et immatériel, est une véritable clé si elle est valorisée dans des partenariats efficaces. Par exemple, les savoirs autochtones sont essentiels pour faire face au changement climatique, mais ils ne sont pas encore suffisamment exploités en dehors des communautés locales.
La jeunesse est également une richesse du continent : 300 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans sont le véritable trésor de l'Afrique. Leur développement dépend de l'éducation, et il est impératif de leur offrir des opportunités pour façonner leur parcours éducatif et professionnel.
Quels sont les obstacles au développement de la recherche en Afrique ?
Ils se situent à trois niveaux :
Premièrement, les instituts de recherche manquent de qualité, de coopération intra- et intercontinentale, et d'outils pour prioriser les recherches. Bien que l'Afrique dispose d'universités, elle souffre d'un manque d'infrastructures de recherche pour connecter les universités, le secteur privé et les systèmes éducatifs, notamment secondaires. Cela est dû à un retard historique lié à l'accès limité à l'éducation.
Deuxièmement, l'enseignement supérieur est marginalisé, tant en Afrique que chez les pays donateurs. Bien que l'Union africaine ait dédié l'année 2024 à l'éducation, les gouvernements africains manquent de ressources pour investir dans ce secteur, en particulier dans l'enseignement supérieur.
Enfin, la qualité de la recherche et de la formation universitaire nécessite un contrôle accru. L'Unesco propose une plateforme pour soutenir ces efforts.
Quelles initiatives concrètes sont mises en place pour combler ce retard ?
L'Unesco a lancé l'initiative "Campus Afrique" structurée autour de trois piliers. Le premier vise à soutenir les capacités des pays et des communautés académiques grâce à une plateforme permettant de partager les expériences positives à travers le continent. Le Rwanda, par exemple, a réalisé des progrès considérables dans la transformation digitale de son système universitaire.
Le deuxième pilier concerne le renforcement des universités qui forment les chercheurs. Lors de la conférence générale de l'Unesco en 2022, de nombreux ministres africains ont demandé une coopération pour créer des universités offrant des doctorats.
Le troisième pilier est la formation technique et professionnelle post-secondaire, nécessaire pour répondre au besoin urgent de création d'emplois pour les jeunes.
Des modèles récents peuvent-ils dynamiser la recherche à l'échelle du continent ?
La Commission économique pour l'Afrique de l'ONU développe un plan d'industrialisation dans des pays comme la Zambie et le Zimbabwe. L'Unesco, présente dans ces pays ainsi qu'en Afrique du Sud, encourage la coopération universitaire dans les secteurs de l'agriculture et de l'énergie. En Côte d'Ivoire, les États généraux de l'éducation nationale ont transformé le système éducatif, avec une attention particulière à l'éducation des femmes.
Comment assurer la parité dans le système éducatif en Afrique ?
Des progrès ont été réalisés au niveau primaire, mais la parité diminue au niveau secondaire, et encore plus à l'université. Il est essentiel de surmonter les barrières culturelles qui limitent l'éducation des filles. L'Unesco a mis en place des programmes pour autonomiser les femmes, tout en respectant les diversités culturelles.
Quel rôle jouent les chaires de l'Unesco pour accélérer la recherche en Afrique ?
Le programme des chaires de l'Unesco, lancé il y a 32 ans, permet aux universités de rejoindre des projets alignés sur les valeurs de l'Unesco. Ce programme favorise les interactions multilatérales dans la recherche et la mobilité des chercheurs. Nous souhaitons accroître la présence de chaires en Afrique, qui représentent actuellement moins de 10 % des 1 100 chaires mondiales.
Comment soutenir l'éducation en temps de crise ?
L'Unesco collabore avec les États pour préparer les systèmes éducatifs à gérer les crises. Par exemple, au Soudan, 19 millions d'enfants ont été déscolarisés à cause de la guerre. L'Unesco élabore un plan de relance pour l'éducation, en travaillant avec les pays voisins pour offrir des possibilités éducatives aux réfugiés.

SOURCE : LE POINT

Nos réalisations
Découvrez nos références, nos réalisations et nos travaux pour des établissements.
C'est tout frais de nos experts

Coût des formations : comment l’outil P2CA va se déployer en 2026