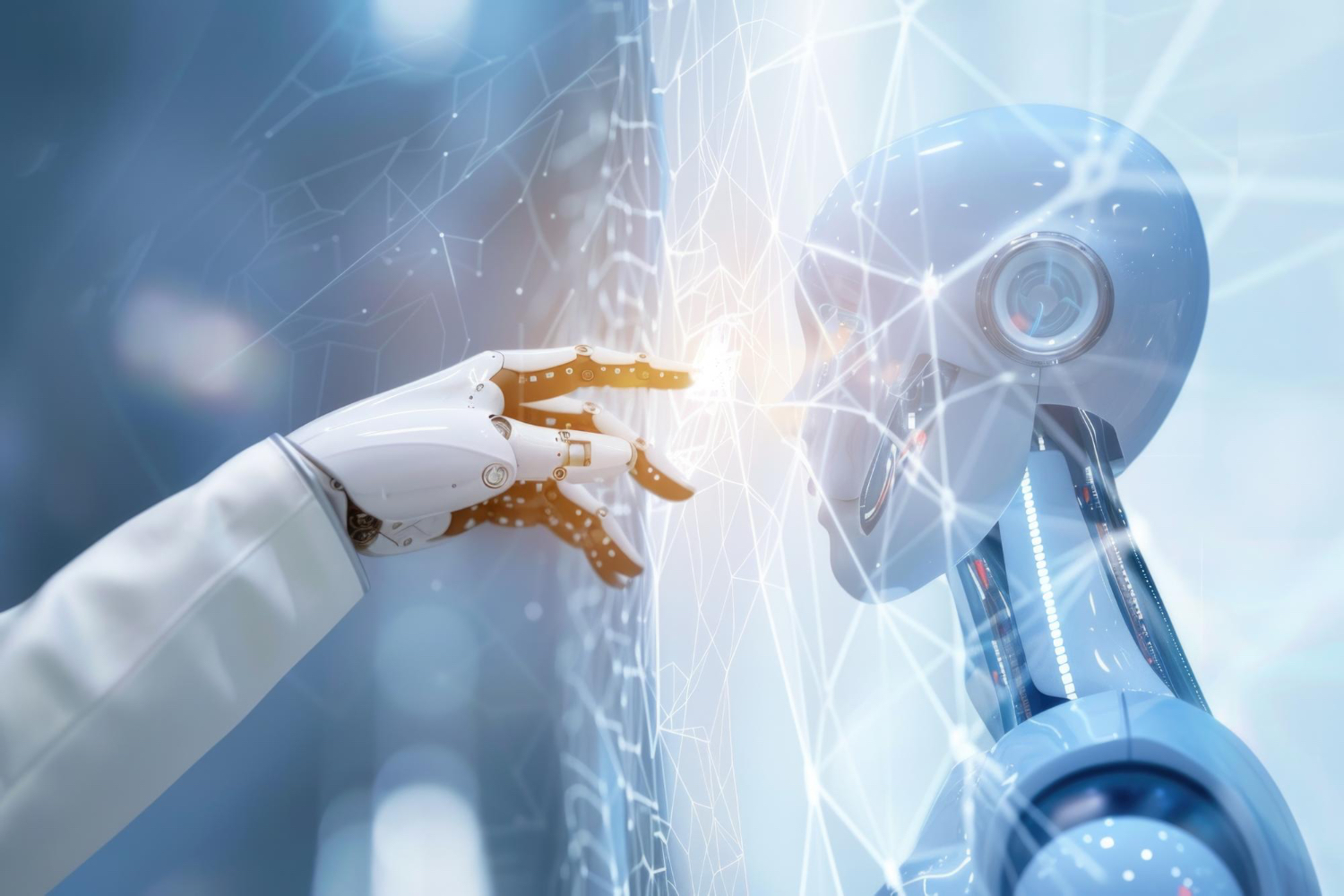L'emprise scolaire : les diplômes ont-ils trop de poids sur nos vies ?

Si l’on admet que la méritocratie est le moins injuste des systèmes, est-il pour autant logique qu’une seule institution, l’école, ait le monopole de la définition du mérite ?
Peu de politiques sont aussi consensuelles que celles menées en France dans le domaine de l'éducation ces dernières décennies. Bien que les modalités pratiques fassent débat, personne ne conteste l’expansion considérable de la scolarisation qui en découle. Depuis les années 1950, le taux de bacheliers a été multiplié par plus de 15. En 1970, seulement 44 % des jeunes de 17 ans étaient scolarisés ; ils le sont presque tous aujourd’hui (96 %).
Un consensus semble s’être établi autour de l’idée que l’éducation scolaire serait le meilleur moyen de former des travailleurs qualifiés et des citoyens actifs, tout en promouvant l’égalité des chances. Pourtant, se demander si ces promesses ont été tenues ne revient pas à remettre en cause la valeur de l’éducation.
Il en est de l’explosion de la scolarisation comme du développement des sciences et de l’industrie, qui ont tant enrichi nos sociétés, mais qui, par leur propre dynamique, ont aussi produit de nouvelles inégalités et dégradé la nature. Il est alors légitime de se demander si nous ne sommes pas arrivés à la fin d’un cycle. Aujourd’hui, les diplômes rythment la vie sociale, influencent le quotidien des familles, et déterminent l’organisation du travail, comme l’illustre l’enquête L’Emprise scolaire – Quand trop d’école tue l’éducation (éd. Presses de Sciences Po, 2024).
Une société plus savante ?
Ouvrir l’accès à l’éducation a bien permis de rehausser le niveau de diplôme de la population, et c’était l’objectif. En Europe, la France se distingue avec plus de 50 % de diplômés du supérieur, un taux supérieur à la moyenne de l’OCDE.
Pour atteindre ce niveau, on a activement poussé les élèves, même ceux avec des acquis limités, à prolonger leurs études, créant ainsi des effets paradoxaux. Si le nombre de diplômés a augmenté, le niveau de compétence de ces derniers n’a pas suivi, notamment chez les bacheliers. Le ministère de l’Éducation observe d’ailleurs une baisse des acquis dès la fin du primaire, surtout chez les élèves en difficulté.
Par conséquent, il est plus facile de prolonger les cursus que d’assurer l’acquisition des fondamentaux pour tous. Pour y parvenir, des investissements strictement pédagogiques, misant davantage sur la qualité que sur la quantité, seraient nécessaires.
Des travailleurs plus qualifiés ?
Influencés par la théorie du capital humain, nous croyons que plus de diplômes équivaut à plus de compétences "rentables" pour l’économie. Mais encore faut-il que ces diplômés puissent réellement exercer leurs compétences. En réalité, la correspondance entre formation et emploi n’existe que pour une minorité de travailleurs. Les flux de diplômés excèdent largement les besoins en emplois qualifiés, ce qui engendre un déclassement par rapport aux attentes.
De plus, la notion de qualification se réduit souvent au diplôme obtenu, alors qu’un métier requiert un panel de compétences bien plus large. À l’évidence, la promesse d’égalité des chances n’a pas été tenue. Les diplômes les plus sélectifs continuent de « payer », mais les jeunes peu ou pas diplômés restent relégués, tandis que la majorité des diplômés de niveau intermédiaire, tels que les bacheliers et licenciés, subissent un déclassement continu.
Le triomphe de la compétition et de l’utilité
Quand tout se joue à l’école, l’utilitarisme domine. On étudie d’abord ce qui est perçu comme utile à la sélection. Cette tendance s’accentue avec la massification scolaire qui renforce la concurrence. Ainsi, la valeur éducative des études est supplantée par leur valeur sélective.
Les familles choisissent les formations et établissements jugés les plus efficaces, indépendamment de leurs valeurs, pour maximiser les chances de réussite. Cette logique renforce le séparatisme scolaire avec des ghettos de riches et de pauvres.
Les élèves se concentrent sur ce qui semble rentable, plutôt que sur ce qui les passionne. Ils sont de plus en plus stressés, tout comme leurs parents qui, quand ils le peuvent, recourent à des soutiens scolaires. Finalement, quand tout se joue à l’école, même l’éducation familiale se scolarise. Les parents deviennent des « coachs », ce qui creuse encore davantage les inégalités scolaires, sans nécessairement favoriser l’épanouissement des jeunes.
Vainqueurs et vaincus
Lorsque l’école a le monopole de la définition du mérite, elle modifie la perception des inégalités. Les parcours scolaires, bien qu’encore influencés par les origines sociales, remplacent les destins de classe. Le discours méritocratique distingue les vainqueurs, qui mériteraient leur succès, des vaincus, jugés responsables de leur échec.
Depuis une trentaine d’années, cette dynamique a profondément transformé les comportements électoraux. Dans de nombreux pays, le vote ouvrier, traditionnellement ancré à gauche, a basculé vers l’abstention et l’extrême droite, car il est devenu le vote des non-diplômés. Ces derniers se sentent méprisés par des élites qui ne doivent leur succès qu’à elles-mêmes.
La dystopie décrite par Michael Young dans The Rise of the Meritocracy il y a plus de soixante ans se réalise. La massification scolaire, en promouvant des valeurs démocratiques, engendre aussi la haine de soi et des autres, et le mépris devient l’émotion sociale la plus partagée.
Faire autrement
La valorisation exclusive de l’égalité des chances méritocratique vise à promouvoir l’accès des élèves les plus méritants aux meilleures écoles et à lutter contre les discriminations qui freinent la mobilité ascendante des jeunes issus de milieux modestes. Mais cette politique centrée sur l’élite laisse de côté la majorité des élèves.
Pour être juste, l’égalité des chances exige de donner la priorité aux plus faibles. C’est pourquoi la formation commune, à savoir l’école élémentaire et le collège en France, devrait assurer à tous les élèves le niveau d’éducation requis pour devenir des citoyens épanouis, avec une attention particulière aux plus vulnérables.

SOURCE : SUD OUEST

Nos réalisations
Découvrez nos références, nos réalisations et nos travaux pour des établissements.
C'est tout frais de nos experts

Coût des formations : comment l’outil P2CA va se déployer en 2026