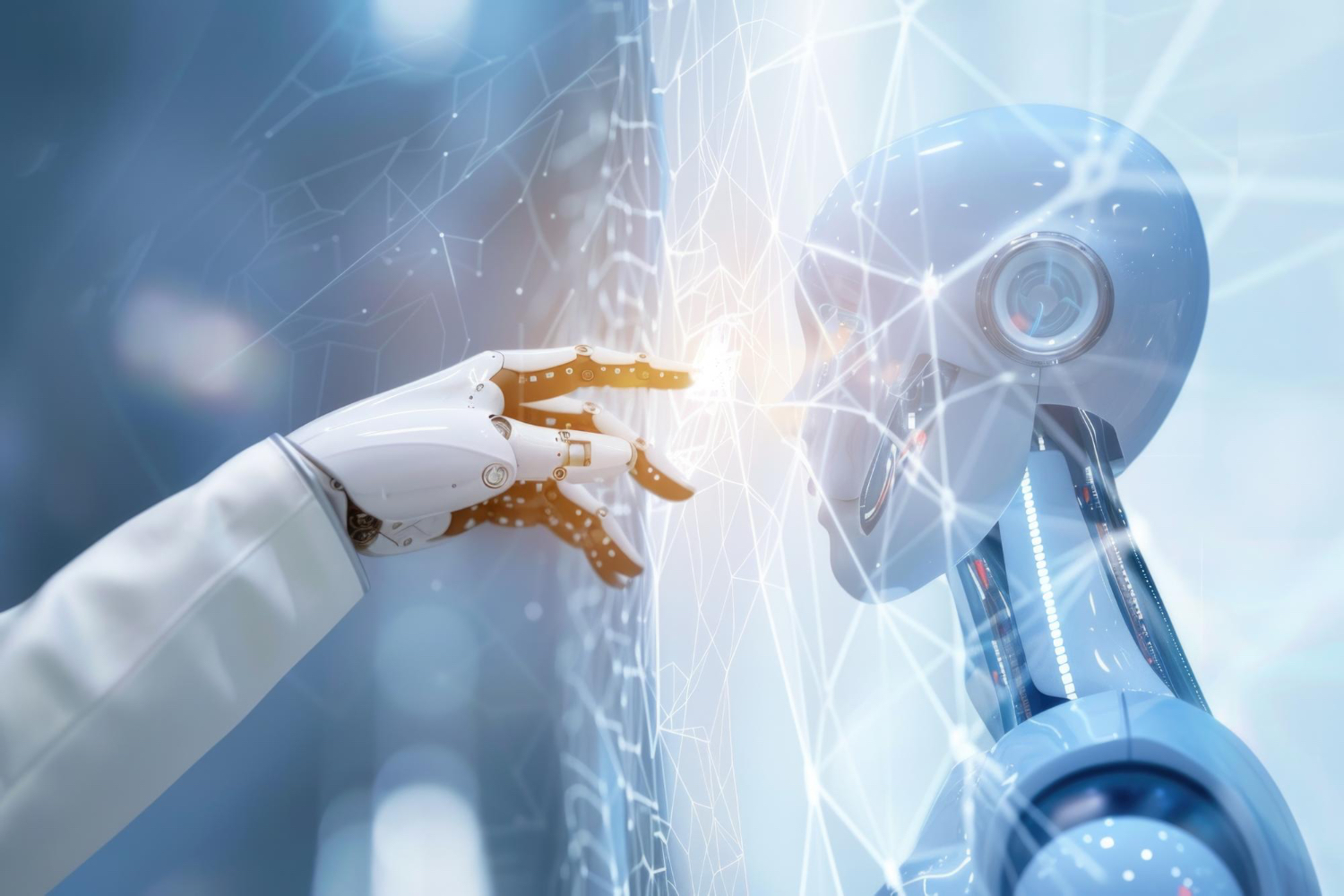l’enjeu n’est plus de l’interdire : comment l’intelligence artificielle secoue l’enseignement supérieur

À l’aube de la rentrée universitaire, alors que les résultats du baccalauréat viennent de tomber, des milliers de jeunes se préparent à entrer dans l’enseignement supérieur. Mais depuis deux ans, un phénomène majeur transforme profondément les méthodes d’évaluation, les pratiques pédagogiques et même la relation entre étudiants et enseignants : l’intelligence artificielle générative. Plus précisément, ces outils d’IA, tels que ChatGPT, bouleversent la façon dont les travaux universitaires sont réalisés et corrigés. Face à cette révolution numérique, les universités, grandes écoles et classes préparatoires cherchent à s’adapter rapidement pour préserver la valeur des diplômes tout en préparant les futurs professionnels à un monde du travail en pleine mutation.
Jessica, 22 ans, étudiante en double master de droit entre Paris et Luxembourg, incarne bien ce changement. Pour elle, l’IA est devenue un allié précieux. « Je ne vois pas de raison de m’en priver », confie-t-elle. Lorsqu’elle prépare ses travaux dirigés ou son mémoire de fin d’études, elle utilise l’IA pour gagner un temps précieux. Mais elle insiste : « Je ne me limite pas à du copier-coller, ce n’est pas une paresse intellectuelle. » Jessica distingue clairement « ceux qui utilisent bien l’outil et ceux qui le font de manière incorrecte ». Selon elle, la clé réside dans une utilisation intelligente et critique de ces technologies. En droit, où la nuance et la précision sont essentielles, ce savoir-faire fait souvent la différence entre une bonne et une mauvaise note.
Elle explique que l’IA lui sert surtout à reformuler des idées qu’elle a déjà en tête, mais qu’elle aurait du mal à exprimer parfaitement, ou à repérer rapidement des sources fiables, qu’elle vérifiera toujours elle-même par la suite. Cette utilisation raisonnée lui fait économiser un temps considérable dans ses recherches, un avantage non négligeable face à la charge de travail intense des études supérieures.
Une adaptation encore en cours
Pourtant, si les étudiants s’approprient ces nouveaux outils, les institutions universitaires françaises sont encore en train de trouver leur voie face à cette transformation. « Les universités françaises se sont emparées de cette problématique avec des rythmes très différents », observe David Catel, professeur-formateur en sciences physiques spécialisé en numérique à l’université d’Orléans. Selon lui, « c’est une des questions les plus vives actuellement », car dans certaines filières, presque 100 % des étudiants utilisent régulièrement l’IA.
Ce constat impose de repenser en profondeur les méthodes d’évaluation. « Nous estimons que le processus de changement ne va pas assez vite au regard des avancées technologiques, mais c’est un chantier complexe », précise-t-il. Face à cette situation, certains enseignants choisissent de renforcer les règles, durcir les consignes ou modifier les barèmes, dans l’espoir de mieux contrôler les pratiques. D’autres au contraire voient dans l’IA une opportunité pour réinventer leurs approches pédagogiques, en ouvrant un dialogue avec les étudiants sur un usage plus responsable, critique et raisonné de ces outils.
Jessica, de son côté, a constaté que son université parisienne durcit de plus en plus sa position : « On sent que les enseignants en ont assez », raconte-t-elle. Depuis peu, ses examens finaux ne sont plus des devoirs à la maison, mais des épreuves écrites sous surveillance stricte, ou des oraux. Ce changement traduit une volonté claire de s’assurer que le travail rendu soit réellement celui de l’étudiant, non assisté par une machine.
De nouvelles pratiques d’évaluation
Dans certains établissements comme l’école d’ingénieurs 3iL à Limoges, les adaptations sont allées plus loin. « Nous avons constaté des dérives, notamment dans les mémoires, travaux pratiques ou rapports de stage réalisés sans encadrement », explique Christophe Durousseau, responsable pédagogique. En réponse, les consignes ont été renforcées : les étudiants doivent désormais citer précisément leurs sources, en mentionnant les pages exactes, afin de garantir la traçabilité et promouvoir une utilisation rigoureuse et transparente de l’IA.
À l’université d’Orléans, les règles sont encore plus strictes lors des évaluations finales. « Pour préserver l’intégrité académique, les examens certificatifs se passent désormais sans aucun appareil électronique, sous surveillance renforcée », précise David Catel. De plus, l’oral gagne en importance, notamment pour les mémoires, avec pour objectif de vérifier la compréhension réelle du sujet.
Ces changements commencent déjà à porter leurs fruits. En deux ans, on observe une nette amélioration des notes écrites, ainsi qu’une progression significative, de deux à trois points en moyenne, de la qualité des rapports de stage. « Il ne fallait pas perdre de temps, il fallait réagir vite », insiste David Catel. « Il s’agissait de préserver la capacité d’analyse des étudiants, et pas seulement leur maîtrise technique de l’IA ».
La répartition des évaluations a également été repensée. Le poids accordé à l’écrit et à l’oral est désormais équilibré, passant d’un ratio de 70/30 à 50/50. Dès l’année prochaine, une nouvelle mesure verra un des deux travaux écrits tiré au sort, noté à l’écrit ou défendu à l’oral, afin de tester les compétences sur plusieurs registres.
L’IA, un outil à intégrer, pas à rejeter
Selon Grégoire Borst, professeur en psychologie éducative à l’université Paris Cité et au CNRS, « l’enjeu n’est plus de détecter ou d’interdire l’usage de l’intelligence artificielle, mais de repenser complètement les modalités d’évaluation ». Pour lui, le système éducatif français reste encore trop centré sur une évaluation sommative, qui ne fait que vérifier ce que l’étudiant sait, sans l’accompagner dans son apprentissage. Il préconise une évaluation plus formative, qui aide à construire les compétences et connaissances nécessaires.
Dans certains établissements, comme à TBS Education à Toulouse, la position a évolué de l’interdiction vers une acceptation pragmatique. « Il ne faut pas être réfractaire, ni jouer les vieux grincheux », explique Kevin Carillo, responsable de master. « L’IA est une nouvelle façon de travailler, une forme de délégation de tâches, et non une menace ». Pour lui, cette révolution est un changement de paradigme aussi puissant que l’arrivée d’internet, qui transforme profondément le monde de l’entreprise.
Préparer les futurs professionnels
Néanmoins, certains professionnels s’inquiètent que cette facilité d’accès à l’IA nuise à la capacité des étudiants à produire eux-mêmes des écrits structurés. « Écrire, c’est structurer sa pensée, son argumentation », rappelle Grégoire Borst. Il suggère ainsi de distinguer les moments où les étudiants peuvent utiliser l’IA, de ceux où ils doivent démontrer leur capacité à réfléchir et rédiger de manière autonome.
Il met en garde contre le risque que l’usage excessif de l’IA donne une vision fragmentaire des sujets étudiés, et affaiblisse la mémoire et la compréhension durables. « L’apprentissage passe par des phases de blocage et de remise en question. Si tout devient trop facile, il ne reste souvent rien », avertit-il.
L’encadrement de l’IA dans l’enseignement ne peut donc pas se réduire à une simple interdiction. « Il faut en parler avec les étudiants, expliquer pourquoi et dans quels cas on leur demande de ne pas utiliser ces outils », affirme-t-il. Il reconnaît que dans certains domaines, l’IA reste peu fiable, et peut produire un travail médiocre, qui pénaliserait l’étudiant.
Enfin, Grégoire Borst rappelle que l’enjeu dépasse la qualité du travail académique. Il alerte sur le risque d’accentuer la fracture numérique entre étudiants. « Ceux issus de milieux favorisés sont généralement mieux équipés et plus à l’aise avec le numérique », souligne-t-il.
Pour aider à cette transition, certains enseignants-chercheurs plus familiers du numérique accompagnent leurs collègues issus de disciplines moins technophiles. À l’université d’Orléans, David Catel a par exemple pris l’initiative de former des professeurs en sciences sociales, lettres ou langues, qui sont de plus en plus nombreux à vouloir comprendre ces outils afin de ne pas être dépassés par une transformation déjà en cours.

SOURCE : BFMTV

Nos réalisations
Découvrez nos références, nos réalisations et nos travaux pour des établissements.
C'est tout frais de nos experts

Coût des formations : comment l’outil P2CA va se déployer en 2026