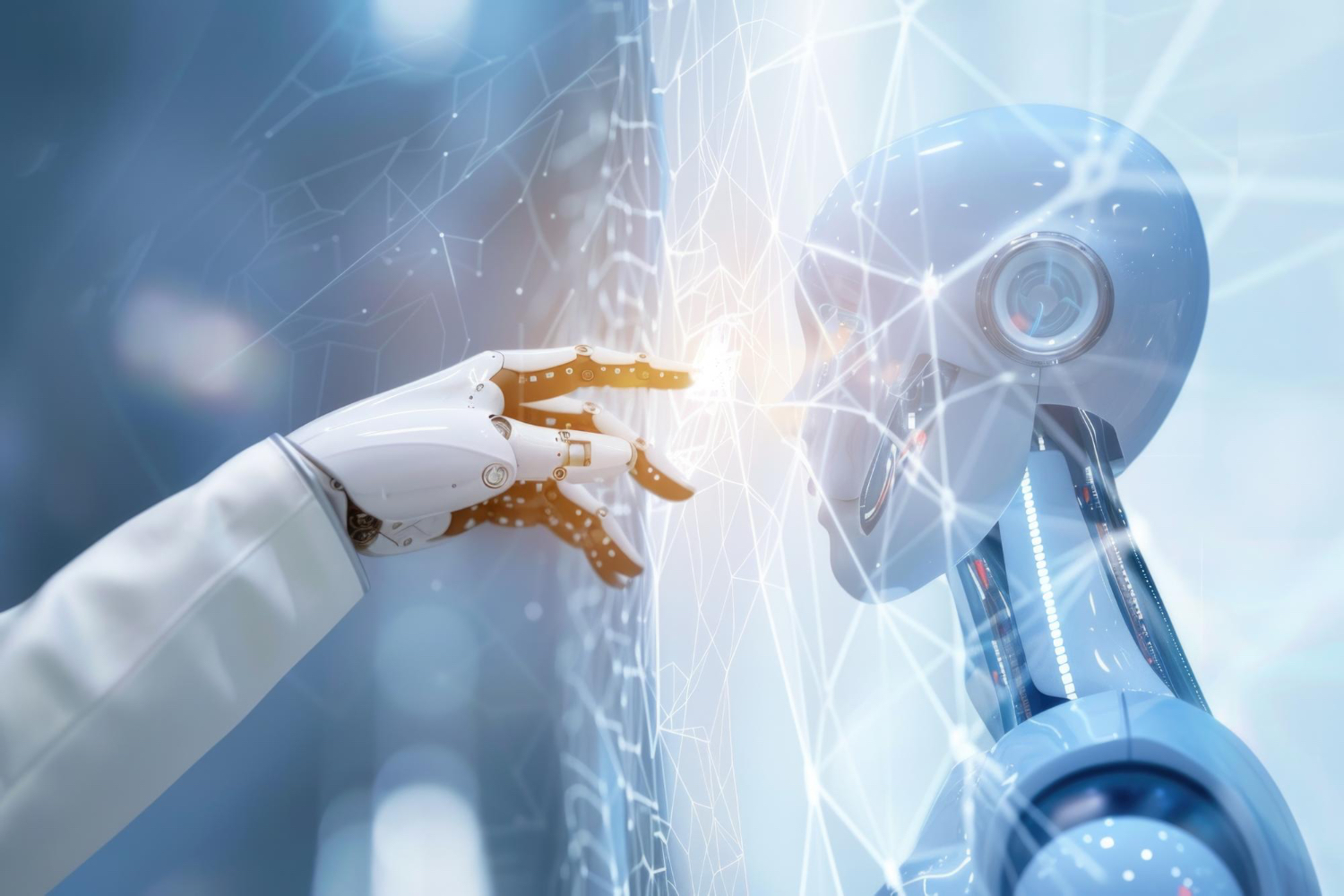Lycée : des clivages entre profils scientifiques et littéraires qui résistent à la réforme du bac

La réforme du baccalauréat, initiée en 2018, visait à abolir la hiérarchie entre les filières traditionnelles (scientifique, économique et sociale, et littéraire) pour mieux préparer les élèves à la transition vers l’enseignement supérieur. Si elle a permis une diversification des parcours, les premières études montrent que certains clivages persistent et que les choix effectués en fin de seconde restent déterminants pour l’avenir des élèves.
Une réforme pour casser la hiérarchie des filières
Jusqu’en 2021, les lycéens choisissaient entre trois séries générales : scientifique (bac S), économique et sociale (bac ES) et littéraire (bac L). Ces filières étaient souvent perçues comme hiérarchisées, le bac S étant considéré comme une « voie royale », largement favorisée dans l’accès aux formations prestigieuses. La réforme de 2018 a remplacé ces séries par un système combinant un socle commun et des enseignements de spécialité (EDS).
Désormais, les élèves choisissent trois spécialités en classe de première, dont deux sont conservées en terminale. Ce système offre une plus grande diversité de parcours avec 286 combinaisons possibles en première et 78 en terminale. L’objectif affiché était de mieux aligner les enseignements du lycée avec les attentes de l’enseignement supérieur.
Des résultats contrastés : entre diversification et reproduction des inégalités
Selon une thèse réalisée à l’Institut de Recherche sur l’Éducation (IREDU) auprès de 15 000 bacheliers de 2022, la réforme a effectivement permis une diversification des parcours disciplinaires. Par exemple, des combinaisons transdisciplinaires comme SES–SVT (sciences économiques et sociales – sciences de la vie et de la terre) sont apparues. Ce type de doublette, mêlant sciences humaines et scientifiques, représente aujourd’hui 14 % des élèves.
Cependant, les clivages sociaux et genrés persistent. Les enseignements scientifiques, tels que les mathématiques ou la physique-chimie, restent majoritairement choisis par des garçons, issus de milieux favorisés, et de très bons élèves. À l’inverse, les spécialités littéraires ou en sciences humaines et sociales sont davantage choisies par des filles, des élèves en difficulté ou issus de milieux populaires.
Les mathématiques : une discipline toujours au centre des inégalités
La réforme a accentué les inégalités en mathématiques. Cette discipline, devenue un prérequis pour de nombreuses formations supérieures, est davantage suivie par les garçons, les élèves des lycées favorisés et ceux bénéficiant d’un meilleur accompagnement à l’orientation. Ces disparités renforcent les inégalités d’accès à certaines filières sélectives, notamment dans les domaines économiques, scientifiques ou technologiques.
Un impact direct sur Parcoursup et la réussite dans le supérieur
Les enseignements de spécialité influencent désormais fortement les candidatures sur Parcoursup, la plateforme d’accès à l’enseignement supérieur. Les formations utilisent des critères spécifiques, et certaines spécialités, comme les mathématiques, deviennent incontournables, même pour des filières non scientifiques.
Les premiers résultats montrent que les élèves ayant suivi des combinaisons scientifiques réussissent mieux dans le supérieur que les profils littéraires, qui continuent de rencontrer des difficultés, souvent liées à l’absence d’enseignement en mathématiques.
Un accompagnement à l’orientation insuffisant
La réforme a rendu les choix en fin de seconde encore plus cruciaux. Ces décisions, qui conditionnent les études post-bac et la réussite dans le supérieur, nécessitent un accompagnement renforcé. Pourtant, les moyens dédiés à l’orientation scolaire demeurent insuffisants dans de nombreux établissements, laissant les élèves et leurs familles parfois livrés à eux-mêmes.
Conclusion : des avancées, mais des inégalités persistantes
Si la réforme du bac a permis une diversification des parcours et une meilleure articulation avec l’enseignement supérieur, elle n’a pas totalement réussi à effacer les clivages sociaux, scolaires et genrés entre profils scientifiques et littéraires. Pour réellement briser ces inégalités, il est essentiel de renforcer l’accompagnement des élèves dans leurs choix d’orientation et de mettre en place des dispositifs adaptés pour soutenir les élèves des milieux moins favorisés.

SOURCE : THE CONVERSATION

Nos réalisations
Découvrez nos références, nos réalisations et nos travaux pour des établissements.
C'est tout frais de nos experts

Coût des formations : comment l’outil P2CA va se déployer en 2026