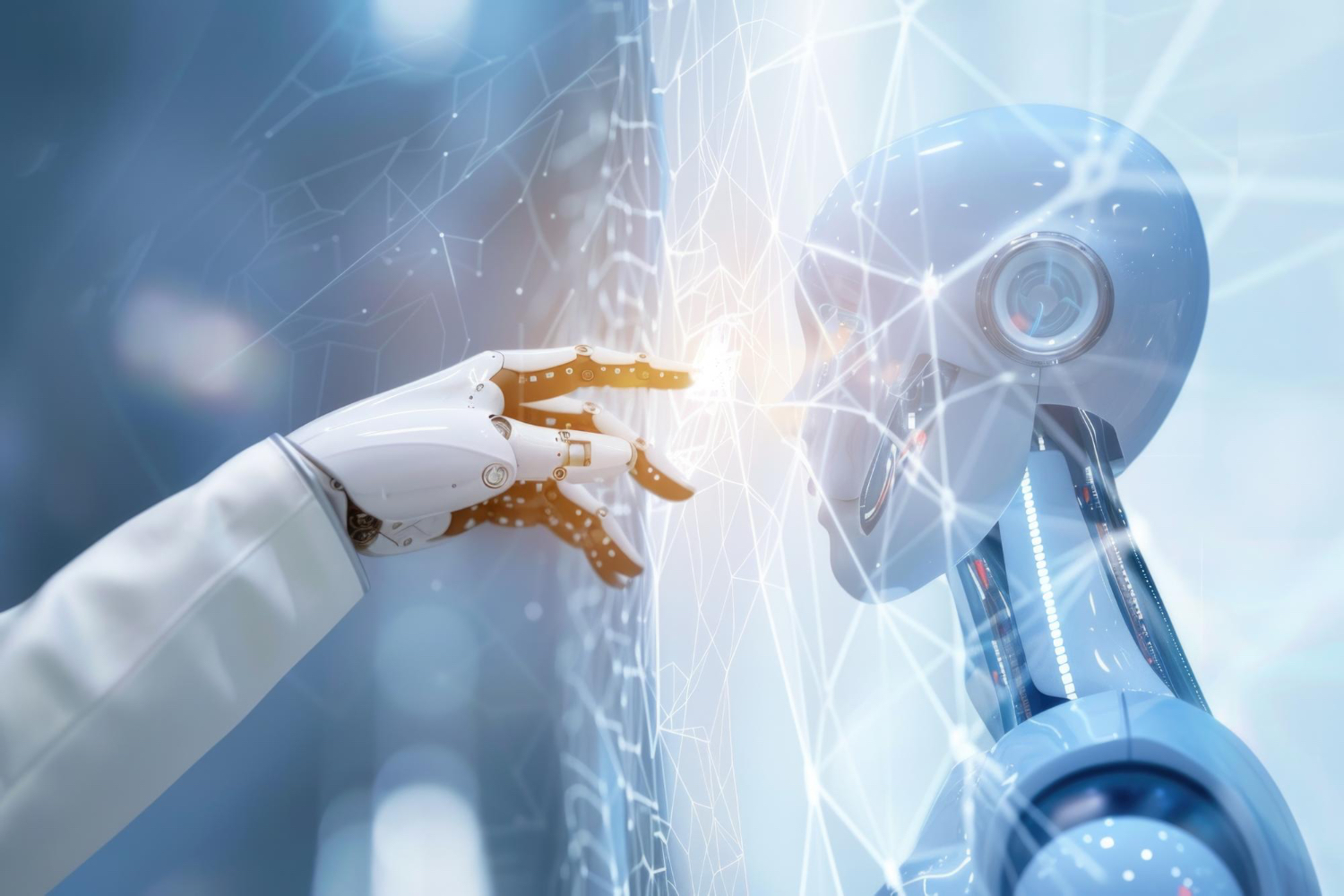Mobilités étudiantes : les villes affûtent leurs plans

Face à une concurrence croissante entre villes universitaires, les collectivités locales redoublent d’efforts pour attirer les étudiants. Comment ces mobilités se construisent-elles, et à quels moments clés ? EducPros analyse les dynamiques en jeu, avec les exemples de Caen et du Havre, deux villes qui misent sur des approches différentes pour capter les flux d’étudiants.
Alors qu’une baisse démographique est attendue d’ici 2029 chez les 15-20 ans, les territoires repensent leur attractivité. Certains accueillent davantage d’établissements privés, d’autres cherchent à se spécialiser dans des domaines précis pour affirmer leur identité dans l’enseignement supérieur.
La coopération entre collectivités, État, régions et établissements d’enseignement supérieur, publics comme privés, est présentée comme un levier essentiel pour maintenir ou accroître l’attractivité des villes universitaires.
Un étudiant sur quatre change d’académie après le bac
Les mobilités interterritoriales se jouent principalement à deux moments : à l’entrée dans l’enseignement supérieur, puis à l’accès en master 1. Lors de la procédure Parcoursup, un étudiant sur quatre change d’académie.
Ces mobilités restent en grande majorité intrarégionales, selon une logique de hiérarchie entre villes : certaines sont considérées comme "dominantes", comme Nantes, tandis que d’autres, telles que Saint-Nazaire, apparaissent comme "dominées", selon une étude de l’Avuf (2022).
Il existe aussi des villes intermédiaires, comme Angers, qui dominent certaines zones tout en restant elles-mêmes sous l’influence d’agglomérations plus grandes.
De grandes villes polarisent les flux étudiants
Certaines métropoles se distinguent sur Parcoursup en attirant davantage d’étudiants d’autres académies. C’est le cas de Lyon ou Lille, identifiées comme très attractives grâce à leur offre large et sélective (CPGE, grandes écoles, filières santé...). À l’inverse, Paris attire peu hors de son académie, ses formations étant en grande partie occupées par les bacheliers franciliens.
Autre cas : les grandes villes enclavées, comme La Rochelle ou Limoges, qui captent aussi des flux en raison de leur isolement relatif dans des régions à faible densité urbaine.
Une mobilité plus forte à l’échelle des zones d’emploi
À une échelle plus fine, celle des zones d’emploi définies par l’Insee, les mobilités apparaissent encore plus marquées. Selon une étude du Sies sur la rentrée 2022, 58 % des néo-bacheliers changent de zone d’emploi en entrant dans le supérieur, bien au-delà des seuls changements d’académie.
Les plus mobiles sont les admis en grandes écoles, qui n’hésitent pas à déménager loin. En master, la mobilité s’amplifie encore : un étudiant sur deux change d’académie, selon les données disponibles. La logique "dominantes/dominées" s’applique ici aussi, mais à une autre échelle.
Les étudiants se concentrent dans les grandes agglomérations
Ces flux renforcent la concentration des étudiants dans les grandes villes, qui bénéficient d’un large éventail de formations. Sur une décennie, cette concentration modifie visiblement la géographie de l’enseignement supérieur.
Souvent, l’université est le moteur de cette dynamique. À Caen, elle regroupe par exemple 70 % des étudiants. Mais d’autres villes, comme Le Havre, s’appuient davantage sur le développement de structures privées pour relancer leur attractivité.
Le Havre mise sur les projets à cofinancement public
Emilie Leproust-Houllier, directrice de l’attractivité du Havre Seine Métropole, décrit une stratégie axée sur le développement de l’offre, en complément de l’université. Créée en 1984, celle-ci reste modeste par rapport à celles de Caen ou Rouen.
La ville mise donc sur des partenariats publics-privés ambitieux, à l’instar d’un projet immobilier à plus de 100 millions d’euros inscrit dans le contrat de plan État-Région, qui doit accueillir une antenne des Arts et Métiers. L’objectif : renforcer les compétences industrielles locales et participer à la réindustrialisation.
À Caen, spécialisation et coordination régionale
De son côté, Caen peut compter sur un nombre d’étudiants en forte croissance, environ trois fois supérieur à celui du Havre. Bertrand Cousin, conseiller à l’attractivité de la communauté urbaine, insiste néanmoins sur le même impératif de coopération entre niveaux institutionnels.
Il plaide pour une spécialisation des villes normandes afin d’éviter la concurrence interne et renforcer la visibilité régionale. Selon lui, avancer en ordre dispersé face à la baisse démographique serait un risque majeur. Il en appelle à la Comue Normandie pour structurer les coopérations entre universités.

SOURCE : Letudiant

Nos réalisations
Découvrez nos références, nos réalisations et nos travaux pour des établissements.
C'est tout frais de nos experts

Coût des formations : comment l’outil P2CA va se déployer en 2026