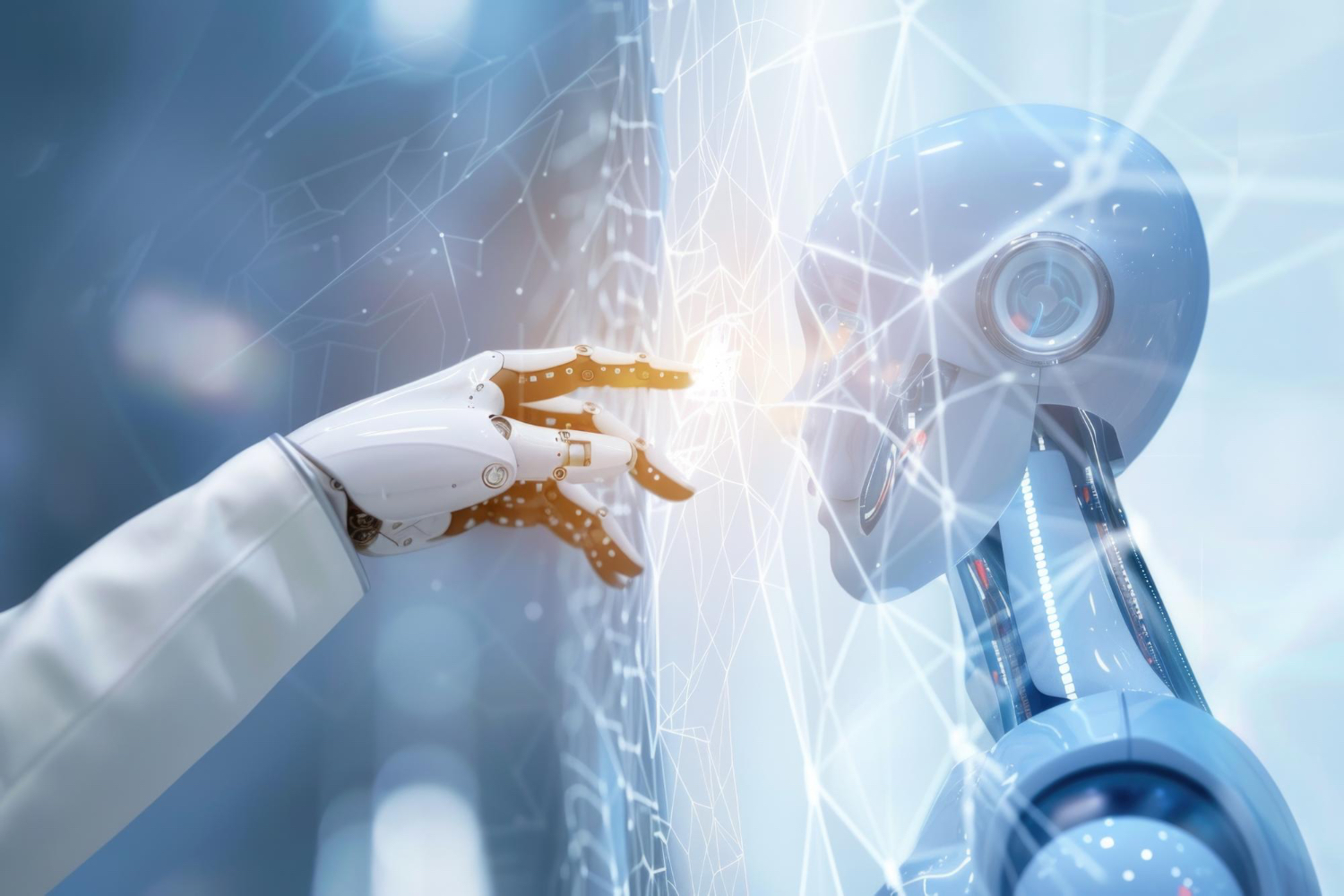Le nombre d'étudiants étrangers en mobilité en France a augmenté de 7 % depuis 2019

Le nombre d'étudiants étrangers en mobilité en France a augmenté de 7 % depuis 2019, selon une note d'information du Sies publiée le 6 mars 2024. En 2022-2023, ces étudiants représentent 11 % de l'ensemble des étudiants de l'enseignement supérieur français, ce qui marque une hausse de 7 % par rapport à 2019. Cette croissance, bien que qualifiée de "modérée", indique une reprise de la mobilité après une période marquée par la crise sanitaire en 2021-2022.
La majorité écrasante (92 %) de ces étudiants effectue une mobilité de diplôme, mais il y a des variations en fonction de l'origine géographique des étudiants. Par exemple, près d'un quart des étudiants en provenance d'un pays membre de l'UE participent à des programmes d'échange comme Erasmus +. Ces programmes étant principalement développés par et au sein de l'Union européenne, les étudiants européens représentent 41 % des étudiants en mobilité d'échange.
L'Afrique est le continent le plus représenté parmi les étudiants en mobilité internationale, bien que seulement 2 % des étudiants africains en mobilité étudient en France dans le cadre d'une mobilité d'échange. En revanche, l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne sont les principaux pourvoyeurs européens d'étudiants en mobilité internationale en France.
Il est également intéressant de noter que la répartition des étudiants européens en mobilité internationale varie d'une académie à l'autre en France, et que les étudiants européens ont tendance à choisir des académies situées à proximité de leur pays d'origine.
En ce qui concerne les étudiants en provenance de l'UE inscrits à l'université, la majorité (64 %) opte pour des cursus menant à un diplôme de type licence. De plus, les femmes sont surreprésentées parmi les étudiants en mobilité internationale en provenance de l'Union européenne, représentant 67 % des effectifs universitaires. Ces différences de genre se manifestent également dans la répartition par discipline, avec une forte présence des femmes dans les lettres et les sciences humaines, mais une représentation moins importante dans les sciences et Staps.

SOURCE : https://www.aefinfo.fr/depeche/709114

Nos réalisations
Découvrez nos références, nos réalisations et nos travaux pour des établissements.
C'est tout frais de nos experts

Coût des formations : comment l’outil P2CA va se déployer en 2026