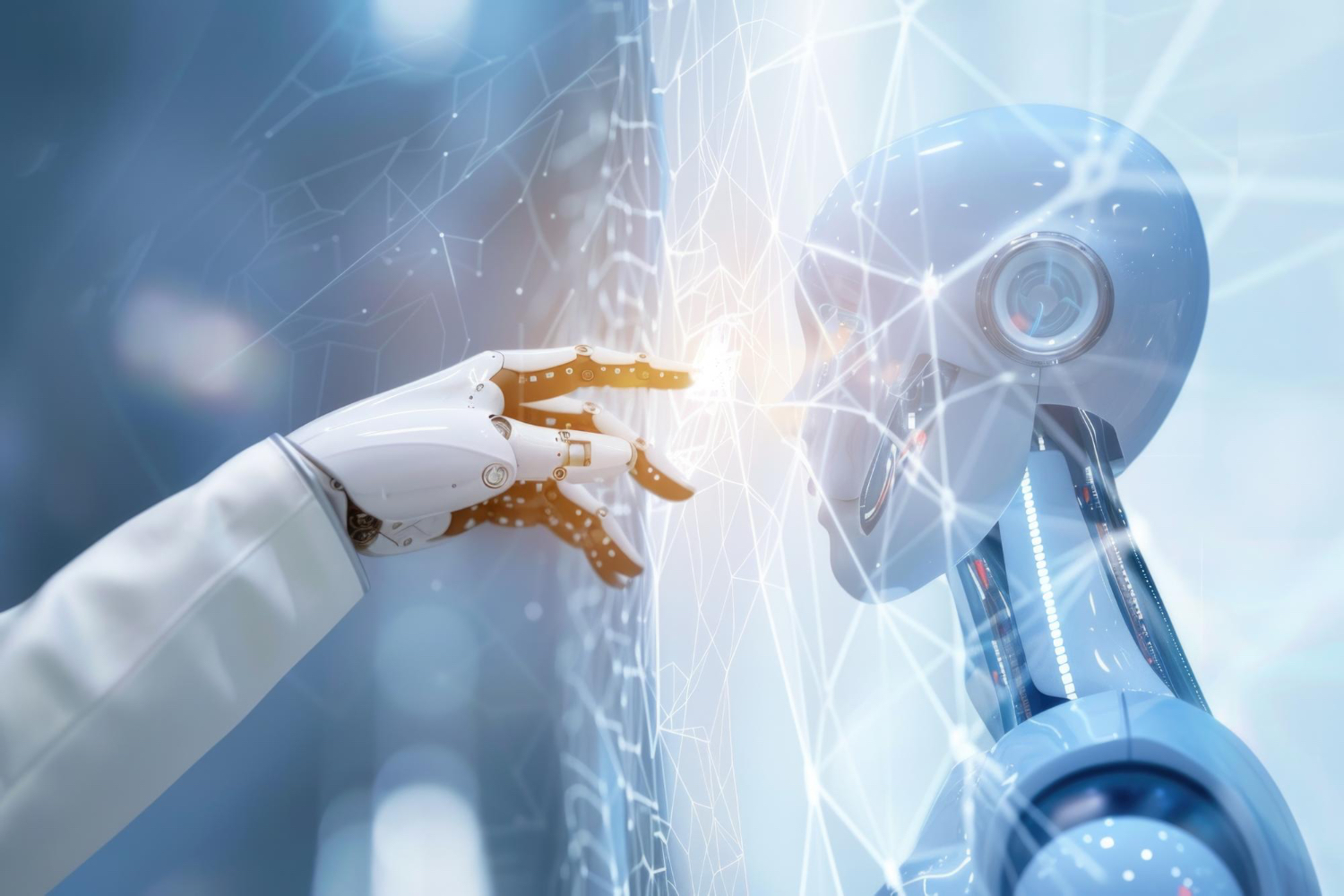Parcoursup : comment améliorer transparence, accompagnement et sélectivité des formations ?

Sept ans après son lancement, Parcoursup continue de répartir chaque année plusieurs centaines de milliers d’étudiants dans l’enseignement supérieur sans dysfonctionnement majeur. Pourtant, la plateforme fait toujours l’objet de critiques, notamment pour son manque de transparence et sa complexité perçue. Alors que l’édition 2025 s’apprête à ouvrir, plusieurs pistes d’amélioration émergent.
Une sélectivité croissante dans certaines formations
L’une des évolutions notables depuis le passage d’APB à Parcoursup est la suppression du classement des vœux. Si cette réforme permet une meilleure répartition des candidats, elle laisse planer un doute sur la satisfaction réelle des étudiants face aux propositions reçues.
Par ailleurs, Parcoursup a renforcé la sélection, même dans les filières non sélectives. Une étude menée en 2022 montre que la proportion de candidats avec mention "Bien" ou "Très bien" dans les licences universitaires est passée de 29 % sous APB à 59 % avec Parcoursup. Cette polarisation des publics favorise les établissements prestigieux, comme ceux du centre de Paris, au détriment des universités moins attractives.
Toutefois, une nuance s’impose : selon le Céreq, seules certaines licences en tension ont été impactées, écartant des candidats en raison de capacités d’accueil limitées.
L’accompagnement à l’orientation : un enjeu central
Si Parcoursup est un outil technique, son efficacité dépend avant tout de l’accompagnement à l’orientation proposé aux élèves, qui doit démarrer dès la classe de seconde. Jérôme Teillard, chef de projet Parcoursup au ministère de l’Enseignement supérieur, rappelle que le problème ne réside pas uniquement dans le nombre de places disponibles, mais également dans la qualité de l’information sur les formations et les débouchés professionnels.
Depuis deux ans, les fiches des formations sont progressivement enrichies des taux d’insertion professionnelle. De plus, Parcoursup permet désormais aux lycéens de créer leur dossier dès la seconde, facilitant ainsi la découverte de nouvelles filières.
Pour Alban Mizzi, doctorant en sociologie, la réintroduction d’un classement des vœux simplifierait les choix des candidats et éviterait les listes d’attente interminables. Toutefois, il insiste sur la nécessité d’un accompagnement renforcé, regrettant que les 54 heures dédiées à l’orientation dans les lycées se traduisent souvent par des séances insuffisantes.
Améliorer la transparence des décisions d’admission
Le manque de transparence est un autre reproche fréquent adressé à Parcoursup. Alban Mizzi propose d’inclure des enseignants du secondaire et des représentants étudiants dans les commissions d’examen des dossiers. Il plaide également pour une communication claire des critères de classement et des décisions d’admission.
Cette transparence, déjà en vigueur au Portugal, permettrait aux candidats de mieux comprendre le processus. Là-bas, les résultats du baccalauréat déterminent l’ordre d’admission, tandis que les barèmes de points et les numerus clausus sont publiés à l’avance.
Parcoursup, un choix politique ?
Pour Annabelle Allouch, maîtresse de conférences en sociologie, Parcoursup est avant tout un outil de sélection. Face à l’augmentation des effectifs et à la baisse des moyens, ce système a été privilégié au détriment d’une création de nouvelles places. Elle souligne que cette logique, déjà présente avec APB, reflète un choix politique assumé, marqué par une standardisation européenne des outils d’admission.
De fait, des voix s’élèvent pour remettre en question Parcoursup, certains plaidant pour sa suppression au profit d’alternatives plus inclusives. Toutefois, l’efficacité du système dépendra de la capacité à :
- Renforcer l’accompagnement à l’orientation dès la seconde ;
- Améliorer la transparence des critères d’admission ;
- Adapter l’offre de formation pour répondre aux besoins des étudiants et du marché.
Conclusion : Si Parcoursup a permis des avancées techniques notables, son amélioration passe par une meilleure transparence, un accompagnement renforcé et des décisions politiques pour répondre aux attentes croissantes des étudiants et des établissements. L’enjeu ? Rendre l’orientation plus fluide, équitable et moins anxiogène pour les futurs bacheliers.

SOURCE : ETUDIANT

Nos réalisations
Découvrez nos références, nos réalisations et nos travaux pour des établissements.
C'est tout frais de nos experts

Coût des formations : comment l’outil P2CA va se déployer en 2026