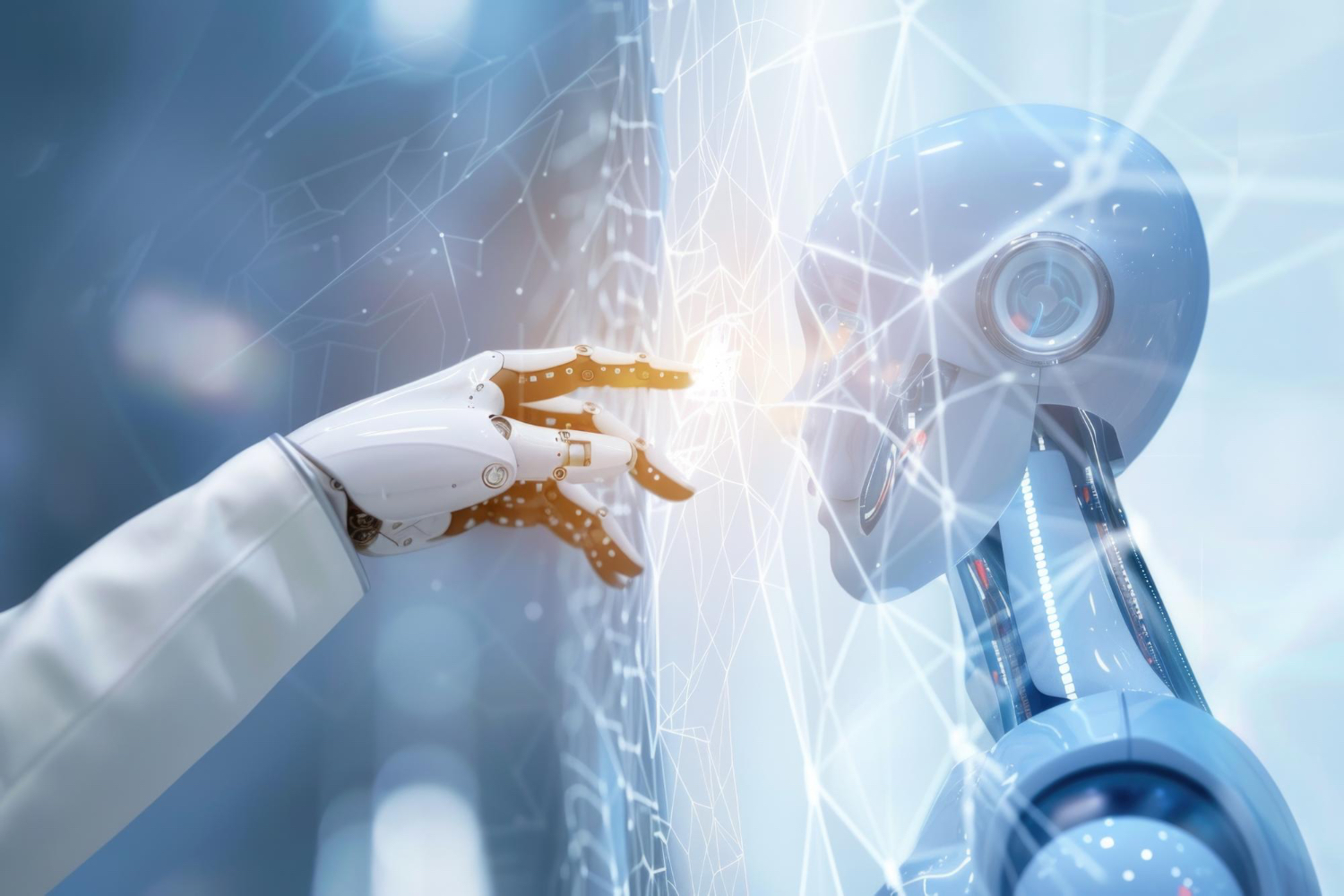Que révèlent les cités éducatives des liens entre école et territoires ?

Examiner les liens entre école et territoires à travers l’exemple des cités éducatives, tel est l’objet d’un article paru au printemps 2025 dans la Revue internationale d’éducation de Sèvres. Les chercheuses expliquent comment ce programme prolonge le mouvement de territorialisation des politiques éducatives lancé dans les années 1980, tout en l’approfondissant. Même si l’État reste présent pour réguler ces politiques par un pilotage "à distance", des tensions émergent, illustrées par plusieurs cas concrets.
Les cités éducatives, prolongement de la territorialisation des politiques
À partir des années 1980, la mise en place de l’éducation prioritaire et les lois de décentralisation ont transformé le rôle de l’État dans la gestion des équipements scolaires, confiant davantage de compétences aux collectivités. L’école française, autrefois centralisée, s’est ainsi engagée dans un mouvement de territorialisation.
Les cités éducatives, créées en 2019 et appelées à être généralisées dans les QPV d’ici 2027, prolongent et approfondissent ce mouvement. Copilotées par une "troïka" (collectivités locales, Éducation nationale, État déconcentré), elles reposent sur une gouvernance interinstitutionnelle. Les chercheuses soulignent l’émergence d’un modèle inédit, où l’établissement scolaire devient partie prenante d’un projet territorial plus large, associé à des partenariats variés.
Une politique éducative territorialisée mais régulée à distance
Si les territoires prennent une place grandissante dans la définition de l’action éducative, l’État central conserve un rôle de régulateur, notamment via les appels à projets et les labels. Les cités éducatives illustrent cette gouvernance "à distance".
Les labels constituent un mode de pilotage souple : ils orientent les acteurs locaux vers des choix jugés collectivement bénéfiques par l’État. Dans ce cadre, les troïkas ont pour mission de transformer à la fois les pratiques des acteurs scolaires et associatifs, mais aussi les modes d’action des institutions qu’elles représentent.
Ce système renforce l’autonomie contrôlée des acteurs et cherche à responsabiliser individus et collectivités dans leurs conduites et décisions.
Quelle opérationnalisation locale des cités éducatives ?
L’article s’intéresse également à la mise en œuvre concrète de ces dispositifs, en étudiant deux cas.
Le premier concerne une cité éducative couvrant l’ensemble d’une ville de Seine-Saint-Denis depuis 2019. Cette échelle large pose des défis de coordination et peut générer des tensions institutionnelles. Les autrices mettent en garde contre l’ajout d’une "couche" supplémentaire dans le millefeuille territorial, qui compliquerait encore la répartition des compétences.
L’enveloppe financière trisannuelle permet de fédérer les acteurs mais peut aussi attiser des concurrences professionnelles, des conflits de légitimité ou des doublons. Ces tensions peuvent toutefois devenir des opportunités pour la ville, qui peut capter des financements supplémentaires, y compris européens.
Les arbitrages financiers discutés dans la troïka révèlent les rapports de force entre État et collectivités, les projets portés par la ville étant parfois sources de conflits sur leur intégration dans les financements de la cité éducative.
Entre tensions et opportunités dans les cités éducatives
Le deuxième cas étudié concerne une cité éducative infracommunale, au centre d’une grande métropole. Les mêmes difficultés apparaissent, liées aux découpages territoriaux qui se superposent.
La cité éducative doit aussi s’articuler avec d’autres projets territorialisés, comme la rénovation d’écoles délabrées ou le dispositif TNE à l’échelle départementale. Cette superposition peut générer des complémentarités mais aussi des tensions, notamment avec l’Éducation nationale, confrontée à la difficulté de mobiliser ses enseignants faute de temps dédié à la concertation.
Les chercheuses soulignent que les enjeux financiers, les rapports de force institutionnels et les différences de cultures professionnelles constituent des obstacles majeurs à la réussite des alliances éducatives.
Enfin, elles estiment qu’un point de vue reste à explorer : celui des habitants, et notamment des enfants, des jeunes et de leurs familles, afin de mieux comprendre leur perception de ces dispositifs.

SOURCE : AEF INFO

Nos réalisations
Découvrez nos références, nos réalisations et nos travaux pour des établissements.
C'est tout frais de nos experts

Coût des formations : comment l’outil P2CA va se déployer en 2026