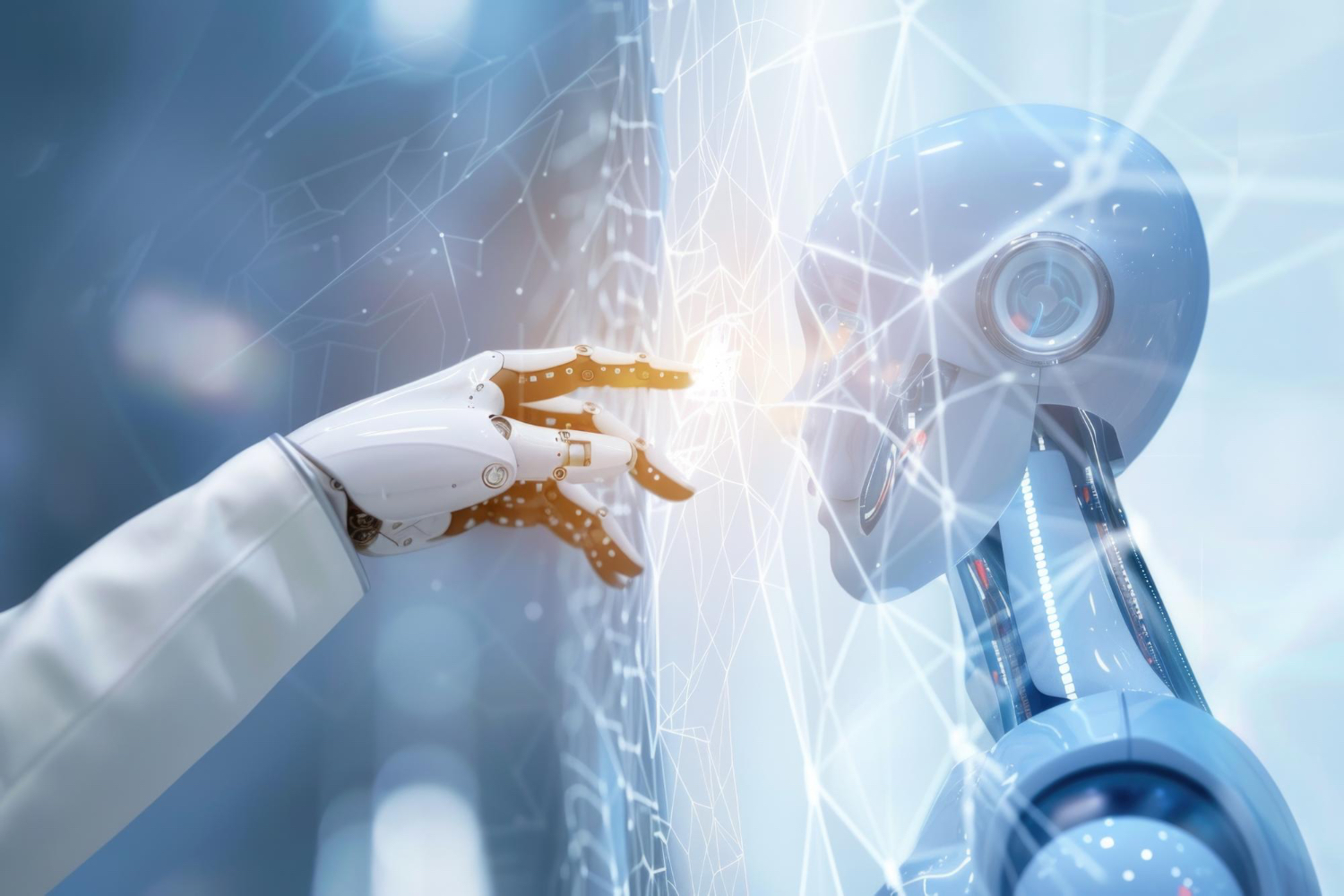Repenser l’éducation prioritaire : le Sénat propose d’intégrer la ruralité et d’élargir les postes à profils

Intégrer la ruralité et repenser la carte de l’éducation prioritaire
Le 9 mai 2025, un rapport d’information sénatorial a été publié dans le prolongement de l’enquête de la Cour des comptes sur la politique d’éducation prioritaire. Son auteur, Olivier Paccaud (LR), y plaide pour une refonte de la carte de l’éducation prioritaire, soulignant que celle-ci n’a pas été revue depuis la réforme de 2015, malgré l’objectif d’une révision tous les quatre ans. Cette inaction serait due à un "manque de volonté politique" ou à une "succession de ministres", selon le sénateur, qui vise notamment Jean-Michel Blanquer.
Il note que la carte actuelle est inadaptée, avec des établissements surclassés ou sous-classés : au moins cinq collèges et 48 écoles ont un IPS supérieur à 110 (contre une moyenne nationale de 105), alors que 16 collèges avec un IPS inférieur à 80 ne sont pas en éducation prioritaire.
Prendre en compte les spécificités de la ruralité
Olivier Paccaud insiste sur l'exclusion injustifiée de la ruralité de la politique d’éducation prioritaire, historiquement fondée sur des critères essentiellement urbains. Il propose d'intégrer des critères spécifiques aux difficultés sociales des territoires ruraux dans la nouvelle carte. Pour lui, les inégalités sociales et les obstacles scolaires en milieu rural doivent être pleinement reconnus.
Ce point divise les élus : certains, comme Patrick Haddad, refusent de faire de la ruralité une priorité au détriment des zones urbaines, tandis que d'autres, comme Bruno Belin, dénoncent une discrimination territoriale.
Vers une logique d’établissement et non plus de réseau
Le rapport souligne les limites de l’actuelle logique de réseau d’éducation prioritaire, qui relie les écoles aux collèges REP/REP+. Cette organisation ne tient pas toujours compte des réalités locales, notamment en milieu urbain dense. Grâce aux données d’IPS disponibles pour chaque école, une approche par établissement permettrait une allocation plus juste des moyens.
Des dispositifs comme les cités éducatives, qui fédèrent divers acteurs autour de projets locaux, sont salués dans le rapport. Ils doivent toutefois s’accompagner d’un renforcement du pilotage interministériel entre Éducation nationale, ministère de la Ville, préfectures et collectivités.
Limites des dispositifs complémentaires
Certaines initiatives comme les contrats locaux d’accompagnement (CLA) et les territoires éducatifs ruraux (TER) sont jugées peu lisibles et peu pérennes. Le caractère expérimental des CLA freine leur ancrage, tandis que les TER ne répondent pas pleinement aux enjeux des zones rurales.
Étendre les postes à profils et revoir les décharges d’enseignement
Le rapport note une amélioration de l’attractivité des postes en REP+, en lien avec des efforts de revalorisation salariale. Le système de postes à profils est jugé pertinent pour les établissements REP/REP+, mais reste trop limité. Le Sénat propose d’étendre cette pratique à d’autres fonctions.
Les décharges d’enseignement, notamment en REP+, sont aussi critiquées. Dans le second degré, elles sont souvent utilisées pour les remplacements de courte durée, au lieu de favoriser le travail collectif et les partenariats éducatifs. Le rapport recommande une nouvelle définition des heures libérées, pour en garantir un usage conforme à leur objectif initial.
Repenser le dédoublement : passer de 12 à 15 élèves
Le dédoublement des classes en grande section, CP et CE1, en vigueur depuis 2017, a un coût élevé. Il crée des tensions sur les ressources humaines et les infrastructures. Le rapport suggère d’augmenter les effectifs à 15 élèves par classe, ce qui permettrait de fermer 839 classes et de redéployer ces postes vers des zones en tension. Une expérimentation du dédoublement au collège est aussi recommandée pour en évaluer l’impact.
Vers une allocation progressive et contractualisée des moyens
Le rapport appelle à une refonte globale des dispositifs existants, afin d’instaurer une politique unique, progressive et concertée d’allocation des moyens. Cette nouvelle approche se baserait sur des indicateurs socio-économiques, une contractualisation annuelle entre établissements et rectorat, et une réduction des politiques fragmentées.
L’objectif est de dynamiser collectivement les équipes éducatives, tout en simplifiant les démarches administratives, notamment par la suppression des projets multiples liés aux politiques spécifiques comme les cités éducatives.

SOURCE : AEFINFO

Nos réalisations
Découvrez nos références, nos réalisations et nos travaux pour des établissements.
C'est tout frais de nos experts

Coût des formations : comment l’outil P2CA va se déployer en 2026