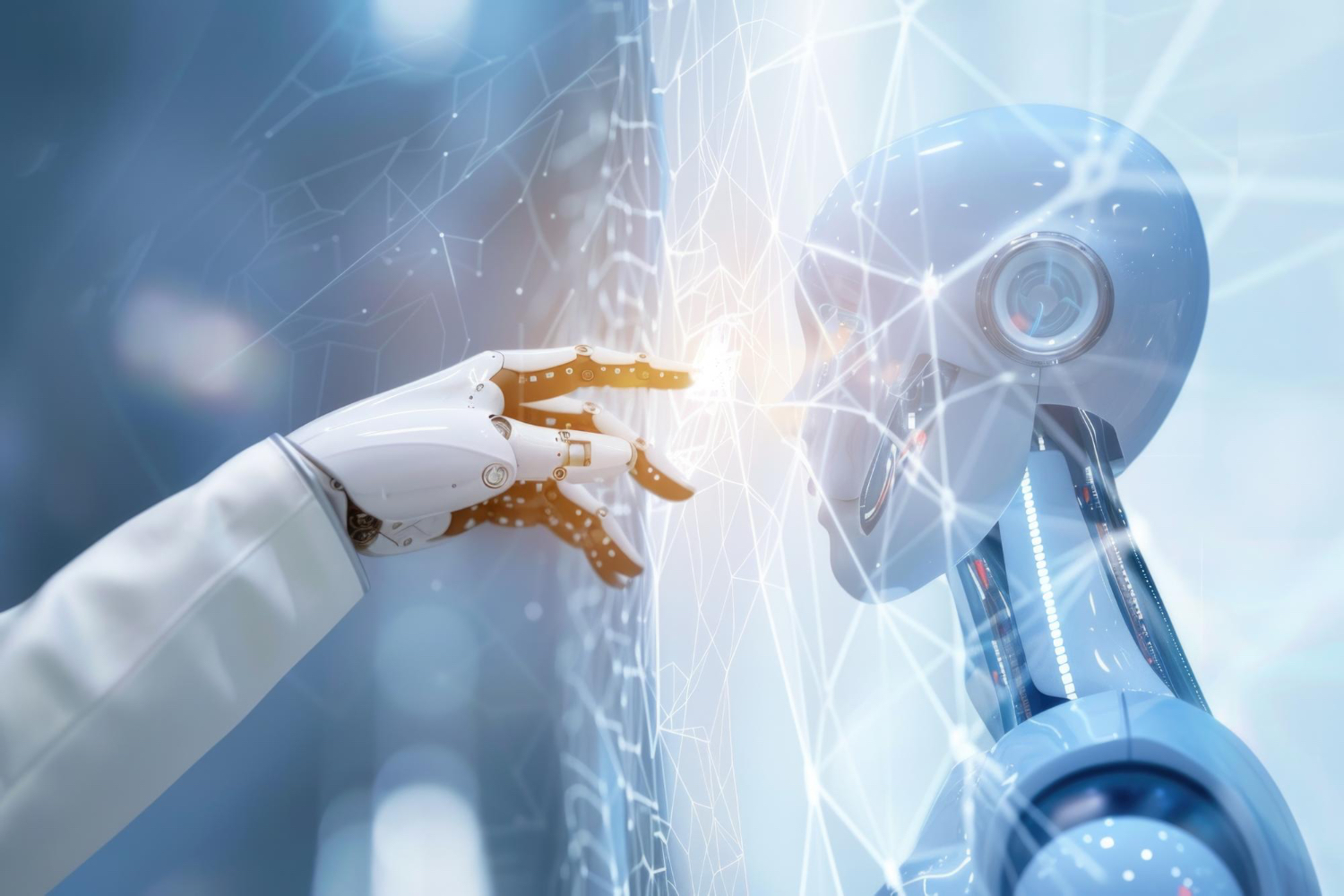Le silence en classe : un atout pour l’apprentissage ou une barrière à l’expression ?

Le silence en classe : un atout pour l’apprentissage ou une barrière à l’expression ?
Le rôle du silence en classe suscite des questions essentielles pour les enseignants et les pédagogues : pour bien apprendre, faut-il que les élèves soient silencieux ? Si le silence a longtemps été associé à l’autorité, il occupe aujourd’hui une place plus complexe, où les notions d’expression, de concentration et de participation se croisent.
Dans l’imaginaire collectif, une classe studieuse est souvent perçue comme un groupe d’élèves concentrés, en rang et plongés dans leurs travaux dans un silence absolu. Mais cette vision correspond-elle réellement aux besoins d’une classe moderne ? Le silence est-il un véritable gage de concentration et d’apprentissage ? Cette question va au-delà des apparences, et touche à la fois aux méthodes pédagogiques et aux modes de communication en classe. Aujourd’hui, le silence est devenu un véritable outil pédagogique, nécessitant un équilibre subtil entre autorité, expression personnelle et interaction.
Silence et autorité : un héritage historique
Pendant longtemps, la pédagogie scolaire s'est fondée sur une écoute passive, avec le silence comme pilier de la discipline. Michel Foucault, dans ses travaux sur le contrôle social, décrit le silence comme un moyen de réguler les comportements et de signifier le respect dû à l'autorité de l'enseignant. Au-delà de la discipline, le silence est utilisé comme un outil de gestion de classe, particulièrement au niveau primaire, pour faciliter la concentration et réduire les distractions.
Cependant, ce silence est souvent difficile à obtenir et demande des stratégies de la part de l’enseignant. Comme l’explique Magali Boizumault :
« Le silence est d’abord un moyen, qui implique la mise en œuvre de gestes professionnels et une mise en scène corporelle de l’enseignant pour donner les consignes au groupe classe. Ensuite, il devient une fin en soi pour instaurer un climat de travail serein. »
Il est toutefois important de noter que le silence n’est pas toujours synonyme de concentration. Un silence imposé peut révéler une absence d’engagement, voire un malaise chez les élèves qui n'osent pas poser de questions. Il revient alors à l’enseignant de décoder le silence et d’évaluer s’il traduit une véritable concentration ou s’il cache une passivité.

Silence et expression : le juste équilibre pour favoriser l’apprentissage
La parole et le dialogue jouent un rôle clé dans l’apprentissage, permettant aux élèves de formuler leurs idées, de partager leurs incompréhensions et d’enrichir leur raisonnement par l’échange. Le silence, dans ce contexte, peut être vu comme un frein à la participation et à l'engagement. Paul Robin, pédagogue du XIXe siècle, prônait déjà une « éducation intégrale » fondée sur l’expression libre plutôt que sur un silence synonyme de passivité. Plus tard, Élise Freinet, figure emblématique de l’éducation nouvelle, critiquera également le silence rigide des classes Montessori, qu’elle compare à l’effervescence de la pédagogie Freinet.
Mais si le silence est souvent perçu comme l’opposé de l’interaction, cette vision mérite d’être nuancée. Certaines recherches montrent que le silence peut favoriser l’autorégulation des élèves, les incitant à se recentrer sur leurs pensées et à traiter l’information de manière autonome. Il devient alors un espace propice pour que chaque élève avance à son propre rythme, selon ses besoins et sa capacité d’intégration des connaissances.
L’équilibre entre silence et parole : vers une approche pédagogique nuancée
Pour qu’une classe devienne un lieu d’apprentissage optimal, un équilibre entre silence et expression est fondamental. Un enseignant qui impose trop de silence risque d’inhiber la créativité et la curiosité des élèves. À l'inverse, un environnement où l'expression est encouragée sans limites peut devenir chaotique et nuire à la concentration. Un climat harmonieux, où le silence et la parole se répondent, peut au contraire stimuler l’engagement et l’implication de tous.
Des activités comme le théâtre, qui valorisent à la fois la parole et les silences, sont d’excellents outils pour apprendre aux élèves à gérer leur prise de parole. De plus, la gestion du silence en classe permet aussi de lutter contre les inégalités, notamment entre les garçons et les filles, en permettant à chacun de trouver sa place dans l’expression verbale et le respect des temps de parole.
Silence et environnement scolaire : un facteur de bien-être
Le silence a également des bienfaits reconnus pour la santé et le bien-être des élèves. Dans une société où le bruit est omniprésent, des moments de silence en classe permettent de réduire le stress et de favoriser le développement des compétences socio-émotionnelles. Le silence en classe, en offrant un espace de calme, permet aux élèves de se recentrer et de mieux appréhender leurs apprentissages.
L’environnement sonore d’une classe ne se limite pas à la manière d’enseigner. Il est aussi influencé par les qualités acoustiques de la salle de classe. Un cadre acoustique inadéquat, avec des bruits parasites, peut compromettre l’efficacité de la gestion sonore et altérer les interactions. Ainsi, un environnement sonore maîtrisé permet d’optimiser le climat de travail et de renforcer les objectifs pédagogiques. Des initiatives comme l’enseignement en plein air ou les espaces de classe flexibles repensent également l’importance du silence et du son dans le processus éducatif.
Le silence : un outil au service de la pédagogie moderne
Le silence en classe, loin d’être un vestige du passé, est aujourd’hui un outil pédagogique précieux. Dans l’apprentissage, savoir jongler entre les moments de silence et les phases d’expression est essentiel pour créer un environnement propice à l’engagement, la concentration et la créativité. En donnant une place adaptée au silence, les enseignants permettent aux élèves de mieux se concentrer, de réfléchir de manière autonome et de respecter le rythme de chacun.
Au-delà de son rôle dans la gestion de la classe, le silence peut ainsi contribuer à une pédagogie plus équilibrée et respectueuse des besoins individuels. En intégrant le silence comme un levier d’apprentissage, les enseignants accompagnent leurs élèves dans un processus d’éducation plus harmonieux, où le calme et la prise de parole se complètent pour favoriser le développement global de chaque élève.
SOURCE : THE CONVERSATION

Nos réalisations
Découvrez nos références, nos réalisations et nos travaux pour des établissements.
C'est tout frais de nos experts

Coût des formations : comment l’outil P2CA va se déployer en 2026